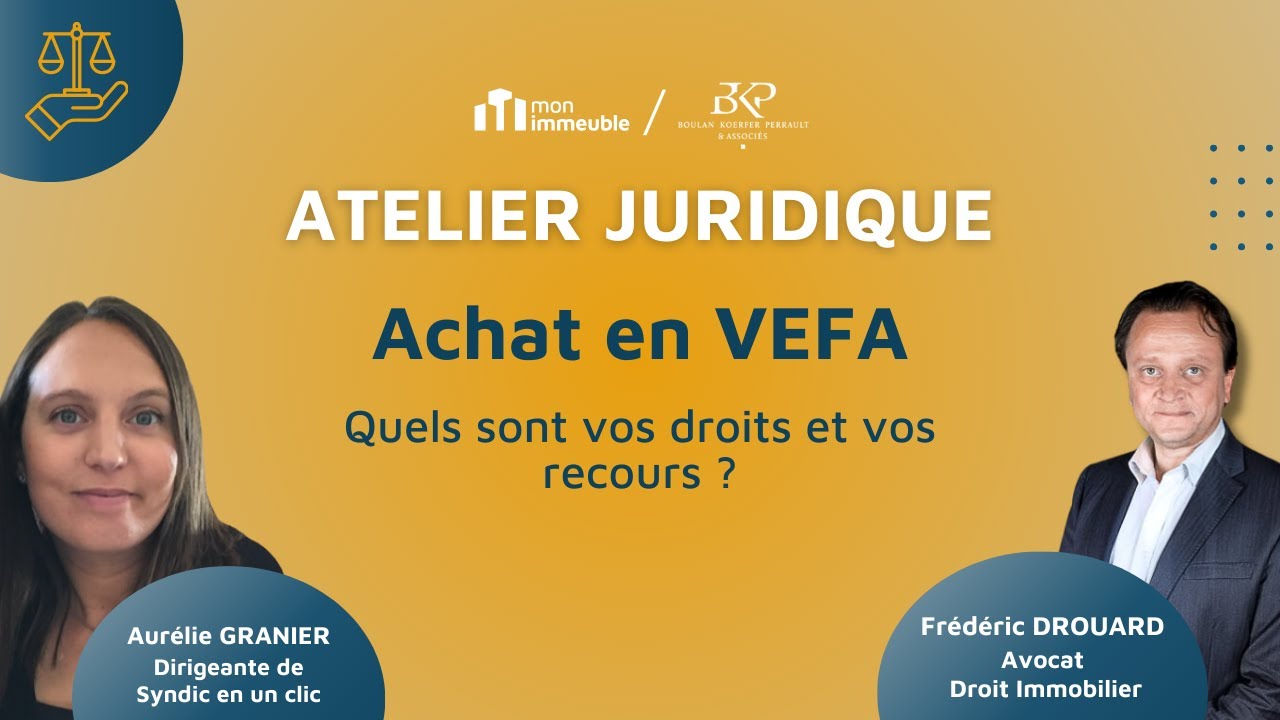Dans notre podcast Copro, Charles Bohbot, avocat associé chez BJA Avocats, revient sur les actualités de la copropriété de l’été et de la rentrée 2025. Entre instabilité gouvernementale et transformations réglementaires, le secteur de l’habitat collectif connaît des bouleversements majeurs. Le Conseil National de l’Habitat vient de publier un rapport sur l’avenir du métier de syndic qui propose la création d’un ordre professionnel. La loi Le Meur sur l’interdiction des meublés touristiques fait face à une question prioritaire de constitutionnalité. Le coefficient de conversion électrique du DPE change et sauve 850 000 logements de l’indécence énergétique. L’emprunt collectif dispose enfin d’un cadre réglementaire avec le décret du 25 juillet 2025. Cet article décrypte les principales évolutions qui façonnent l’avenir de l’habitat collectif.
Sommaire :
- Quel avenir pour le métier de syndic ?
- Les actualités de la copropriété qui concernent les meublés touristiques
- Comment protéger les logements contre la chaleur excessive ?
- Quelles actualités de la copropriété sur le DPE pour les petits logements ?
- L’encadrement des loyers va-t-il se renforcer ?
- Comment fonctionne la répartition des charges lors d’une vente ?
- L’emprunt collectif devient-il vraiment accessible ?
- Quelles nouvelles obligations pour le registre d’immatriculation ?
- Faut-il réaliser un diagnostic structurel de sa copropriété ?
- Quelles actualités de la copropriété sur les bornes de recharge électrique ?
- Le paiement tardif des charges évite-t-il les frais de justice ?
À retenir – Actualités de la copropriété 2025
- Un rapport majeur propose la création d’un ordre des syndics pour professionnaliser le métier et renforcer son rôle dans la rénovation énergétique, avec trois scénarios envisagés.
- La loi Le Meur sur l’interdiction des meublés touristiques fait face à une question prioritaire de constitutionnalité.
- 850 000 logements sont sauvés de l’indécence énergétique grâce à la révision du coefficient de conversion électrique du DPE.
- L’emprunt collectif dispose enfin d’un cadre réglementaire clair avec le décret du 25 juillet 2025.
- De nouvelles obligations s’imposent aux syndics : actualisation du registre d’immatriculation avec davantage de données, diagnostic structurel dans certaines zones, et encadrement renforcé des procédures.
Quel avenir pour le métier de syndic ?
Le rapport commandé par le Conseil National de l’Habitat (CNH) marque une étape clé dans les actualités de la copropriété. Piloté par Henri Buzy-Cazaux, expert reconnu du secteur immobilier, ce travail s’appuie sur les entretiens de plus de 85 parties prenantes pour dresser un diagnostic complet de la profession. Le CNH, souvent qualifié de « petit parlement du logement », réunit l’ensemble des acteurs du secteur pour débattre des politiques publiques en matière d’habitat.
La rénovation énergétique au cœur du métier de syndic
Le rapport place la rénovation énergétique au centre des missions du syndic. En effet, il recommande d’intégrer cette compétence à la formation obligatoire, au même titre que la déontologie ou la lutte contre les discriminations. Les syndics voient par ailleurs leur rôle s’élargir à de nouvelles missions sociales : lutte contre les violences conjugales et contre l’habitat indigne.
Comme le souligne Charles Bohbot, cette évolution traduit une volonté claire : « Former davantage les syndics pour que la rénovation énergétique devienne une composante essentielle de leur formation, au même titre que la déontologie. »
Un contrat type de syndic à réformer d’urgence
Par ailleurs, le rapport pointe un dysfonctionnement structurel : le contrat type de syndic, instauré par la loi ALUR, n’a pas été actualisé depuis 2015, alors que la loi prévoit une révision tous les deux ans.
En outre, ce retard engendre des zones grises sur la rémunération des syndics dans les opérations complexes — diagnostics techniques, gestion d’emprunts collectifs ou coordination de travaux. Le rapport identifie ainsi plusieurs « trous dans la raquette » et appelle à une meilleure rétribution des missions liées à la transition énergétique.

Simplifier la gestion et les outils numériques
Autre recommandation forte : améliorer l’interopérabilité des logiciels métiers. Le transfert d’archives reste aujourd’hui une difficulté majeure lors d’un changement de syndic. Ainsi, le rapport suggère d’imposer des obligations aux éditeurs pour garantir la compatibilité des systèmes, fluidifier la transmission des données et moderniser la profession.
Vers un ordre professionnel des syndics ?
Enfin, la proposition la plus débattue concerne la création d’un ordre professionnel. Actuellement, les syndics exercent sous le régime de la loi Hoguet, sans véritable cadre déontologique renforcé. Trois pistes sont évoquées :
- Renforcer les pouvoirs de la commission de contrôle du CNTGI ;
- Instaurer une corégulation avec les syndicats professionnels ;
- Ou créer un ordre professionnel à part entière, à l’image des avocats ou des notaires.
Cette réflexion marque une évolution majeure : elle interroge le statut, la reconnaissance et la responsabilité des syndics dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant.
Charles Bohbot précise : “Les syndics ne fuient pas leurs responsabilités, au contraire, ils souhaiteraient les endosser. Pourquoi pas une commission de contrôle pour le CNTGI avec des pouvoirs renforcés ?”.

Les actualités de la copropriété qui concernent les meublés touristiques
Les actualités de la copropriété connaissent un nouveau rebondissement juridique majeur. La loi Le Meur, adoptée pour faciliter l’interdiction des locations de courte durée de type Airbnb dans les copropriétés, fait désormais l’objet d’une contestation constitutionnelle susceptible d’en compromettre la validité. Cette loi visait à offrir aux copropriétés un outil concret contre les troubles récurrents causés par les locations saisonnières : nuisances sonores, passages incessants et dégradation du cadre de vie.
En effet, ce texte permet d’interdire ces locations à la double majorité de l’article 26 (majorité des copropriétaires présents et deux tiers des voix). Une passerelle vers la majorité simple de l’article 25 s’ouvre si le tiers des voix est atteint, rendant la mesure plus accessible. Malgré ce cadre, peu de copropriétés ont encore utilisé ce dispositif, souvent par méconnaissance ou par prudence juridique.
Une contestation portée devant le Conseil constitutionnel
Le 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Caen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi Le Meur. Les avocats des bailleurs estiment que cette disposition porte atteinte au droit de propriété. La Cour de cassation devra décider de la transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Les opposants s’appuient sur un précédent de 2014, lorsque le Conseil constitutionnel avait censuré une mesure similaire de la loi ALUR. Toutefois, la loi Le Meur introduit des garde-fous supplémentaires et une majorité renforcée, ce qui pourrait la distinguer du dispositif annulé à l’époque.
Malgré cette incertitude, les juristes rappellent que les interdictions votées avant une éventuelle censure resteraient valables. En effet, le Conseil constitutionnel applique rarement un effet rétroactif à ses décisions.
Charles Bohbot recommande néanmoins la prudence : « En assemblée générale, il conviendra d’évoquer le risque constitutionnel et de voir si les copropriétaires, en connaissance de cause, souhaitent ou non aller vers une interdiction de la location meublée saisonnière. »
Certains observateurs évoquent même un “effet d’aubaine”, incitant les copropriétés à voter rapidement l’interdiction avant une éventuelle décision défavorable du Conseil constitutionnel.
Comment protéger les logements contre la chaleur excessive ?
Une proposition de loi inédite vient enrichir les actualités de la copropriété. Surnommé le projet de “loi bouilloire thermique”, le texte — officiellement intitulé « loi visant à adapter les logements en forte chaleur et à protéger leurs occupants » — entend répondre à un enjeu croissant : la protection des logements contre les canicules à répétition. Si les passoires thermiques occupent depuis des années le devant de la scène politique, leurs pendants estivaux — les bouilloires thermiques — émergent désormais comme un nouveau fléau du confort d’habitat. Dans certaines copropriétés, les températures dépassent 35°C en été, rendant les logements impropres à la vie quotidienne.
Face à ce constat, la proposition de loi met l’accent sur une solution concrète et peu coûteuse : l’installation de protections solaires extérieures (stores, brise-soleil, volets, pare-soleil), efficaces pour réduire la surchauffe et limiter le recours à la climatisation. Le texte prévoit de modifier l’article 8-1-2 de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété. L’objectif : clarifier les règles d’installation individuelle de protections solaires extérieures. Chaque règlement de copropriété devra désormais spécifier les dispositifs autorisés et leurs conditions d’harmonisation de façade, afin de lever les incertitudes juridiques qui freinent actuellement les copropriétaires.
La proposition introduit également un nouvel article 24 M, qui permettrait de voter à la majorité simple de l’article 24 les travaux d’installation de protections solaires extérieures. Cette simplification représente un changement majeur. Puisque le syndicat des copropriétaires pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux — même sur parties privatives — à condition d’obtenir l’accord du copropriétaire concerné. Cette majorité allégée rendrait alors la décision beaucoup plus accessible que celle de l’article 25, actuellement requise pour les travaux d’efficacité énergétique.
Quelles actualités de la copropriété sur le DPE pour les petits logements ?
Le coefficient de conversion de l’électricité dans le calcul du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) passe de 2,3 à 1,9.
Charles Bohbot observe : “Cette modification technique sauve environ 850 000 logements de la classification en passoire énergétique. C’est quand même pas négligeable ! Il y avait une injustice sur ces petits appartements qui ne pouvaient pas changer d’étiquettes.”
Cette révision technique du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) vient corriger une injustice longtemps dénoncée. De nombreux petits appartements, notamment situés sous les toits ou chauffés à l’électricité, se retrouvaient injustement classés en G. Ces logements risquaient d’être interdits à la location pour cause d’indécence énergétique, alors même que leur consommation réelle restait modérée.
Face à ces blocages, plusieurs propositions de loi avaient tenté de reporter les échéances d’interdiction de location des passoires thermiques. Le gouvernement a finalement choisi une voie plus pragmatique : corriger le calcul lui-même plutôt que de repousser les dates. Cette approche rétablit une équité énergétique entre les différentes sources de chauffage et sauve de nombreux petits logements d’une interdiction injustifiée.
L’encadrement des loyers va-t-il se renforcer ?
Un rapport parlementaire présenté par les députés Annaïg Le Meur et Iñaki Echaniz relance le débat sur l’avenir de l’encadrement des loyers. Cette mesure, encore expérimentale et juridiquement contestée, pourrait devenir définitive. Une évolution qui suscite de vives inquiétudes chez les propriétaires bailleurs, déjà fragilisés par les contraintes réglementaires.
Initialement introduit à titre expérimental, le dispositif d’encadrement des loyers fait encore l’objet de plusieurs recours devant les juridictions administratives. Le rapport Le Meur-Echaniz préconise désormais de pérenniser le dispositif, autrement dit de le sortir du statut provisoire pour en faire une mesure permanente du droit locatif français. Cette consolidation vise, selon les auteurs, à garantir une meilleure stabilité juridique et à renforcer la protection des locataires dans les zones dites tendues.
Des sanctions plus lourdes et un rôle accru des maires
Les députés recommandent également de doubler les amendes infligées aux propriétaires qui dépassent les plafonds de loyers. Ils souhaitent, en parallèle, renforcer le rôle des maires dans le contrôle et la mise en œuvre du dispositif, tout en étendant l’encadrement à de nouvelles métropoles comme Lyon ou Bordeaux. Ces ajustements visent à améliorer la régulation du marché locatif et à protéger les locataires les plus modestes face à la flambée des prix du logement.
Des propriétaires de plus en plus découragés
Du côté des syndicats de propriétaires, la réaction est sans appel : le dispositif freine l’investissement locatif et aggrave la pénurie de logements disponibles. Entre la pression croissante liée à la rénovation énergétique et l’impossibilité d’ajuster librement les loyers, de nombreux bailleurs envisagent désormais de vendre leurs biens plutôt que de les louer. Les actualités de la copropriété traduisent ainsi une tension croissante entre deux impératifs : d’un côté, la protection sociale des locataires, et de l’autre, l’attractivité économique de l’investissement immobilier. Un équilibre que le futur cadre législatif devra impérativement redéfinir.
Comment fonctionne la répartition des charges lors d’une vente ?
Les transactions immobilières en copropriété soulèvent souvent la même interrogation : qui doit s’acquitter des charges communes, le vendeur ou l’acquéreur ? Un article signé par Salimata Dieng, membre du cabinet BJA, apporte une réponse juridique précise à cette question récurrente.
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 établit une distinction nette entre les responsabilités financières des deux parties :
- Le vendeur reste redevable des provisions sur budget prévisionnel votées avant la vente.
- L’acquéreur, pour sa part, assume les charges non prévues au budget prévisionnel ainsi que les régularisations intervenant après la vente. Cette répartition s’impose de plein droit et s’applique indépendamment de toute convention privée.
Le moment de la notification de la vente au syndic constitue le point pivot de cette répartition. Pour être valable, la notification doit respecter un formalisme strict défini par la loi. Une notification mal réalisée peut entraîner des litiges coûteux, en brouillant la frontière entre les charges dues par le vendeur et celles relevant de l’acquéreur.
Comme le rappelle Charles Bohbot, avocat spécialisé en droit de la copropriété : “Il y a des formalités et un formalisme à respecter, et des accords contractuels qui peuvent intervenir, mais qui n’ont d’effets qu’entre eux.”
Le vendeur et l’acquéreur peuvent convenir de modalités différentes dans la promesse de vente ou dans l’acte authentique. Cependant, ces arrangements contractuels n’ont d’effet qu’entre eux et ne s’imposent pas au syndicat des copropriétaires. Le syndic, tenu d’appliquer la loi, respecte exclusivement les règles de l’article 6-2 du décret de 1967, sans tenir compte des accords privés conclus entre les parties.
L’emprunt collectif devient-il vraiment accessible ?
Très attendu par les professionnels, le décret du 25 juillet 2025 vient encadrer officiellement l’emprunt collectif pour les syndicats de copropriétaires ainsi que l’intervention du fonds de garantie destiné à la rénovation énergétique. Cette réforme, issue de la loi “Habitat dégradé”, marque un tournant majeur dans le financement des travaux en copropriété.
Comme l’explique Charles Bohbot, avocat spécialisé en droit de la copropriété : « L’emprunt collectif avant était à adhésion individuelle. Avec le nouvel emprunt collectif, on a inversé le principe et l’exception, c’est-à-dire que qui ne dit mot emprunte. »
Désormais, dès que les travaux et l’emprunt sont votés en assemblée générale, tous les copropriétaires sont réputés participants par défaut. Seuls ceux qui expriment explicitement leur refus doivent régler leur quote-part comptant dans les six mois. En pratique, le nouvel emprunt collectif devient quasi obligatoire.
Le décret fixe également les conditions de défaillance d’un copropriétaire. Le syndic doit d’abord envoyer des relances, puis une mise en demeure restée sans réponse pendant plus de 30 jours. Si cette procédure n’est pas respectée scrupuleusement, le syndicat risque de rester redevable de l’intégralité du prêt. Le fonds de garantie intervient ensuite pour prendre le relais des copropriétaires défaillants, assurant ainsi la continuité du remboursement et la protection de la collectivité.
Le décret définit désormais la durée maximale des prêts, fixée à 25 ans, ainsi que les modalités d’intervention du fonds de garantie. Cependant, aucune banque ne propose encore officiellement ce type d’emprunt collectif. Les organismes de caution doivent également se positionner avant que le dispositif ne soit pleinement opérationnel.
Charles Bohbot résume la situation avec lucidité : « Pour l’instant, il n’y a pas encore d’offre établie. On les attend de pied ferme. »
Quelles nouvelles obligations pour le registre d’immatriculation ?
Un décret récent du 19 août 2025 vient préciser les nouvelles données à transmettre lors de l’actualisation du registre d’immatriculation des copropriétés. Ces dispositions, qui s’inscrivent dans la stratégie nationale de rénovation du parc immobilier, alourdissent sensiblement la charge administrative des syndics, déjà très sollicités.
Géré par l’ANAH, le registre d’immatriculation a pour mission de surveiller l’état du parc de copropriétés et de suivre sa rénovation progressive. L’arrêté impose désormais la transmission de données complémentaires relatives à :
- la performance énergétique des bâtiments,
- les systèmes de chauffage et de ventilation,
- le plan pluriannuel de travaux (PPT),
- et les propriétaires occupants.
Ces informations visent à mieux identifier les copropriétés en difficulté et à orienter les politiques publiques de rénovation énergétique.
L’obligation prendra effet 18 mois après la publication de l’arrêté. Ce délai transitoire doit permettre aux éditeurs de logiciels métiers d’adapter leurs outils numériques afin de faciliter la saisie et la transmission automatique des données. Les syndics bénéficieront ainsi de solutions plus ergonomiques, limitant le risque d’erreurs ou d’omissions.
Par ailleurs, certaines données du registre seront rendues accessibles au public, renforçant la transparence sur l’état des immeubles. Les notaires, quant à eux, disposeront d’un accès complet à ces informations, leur permettant de préparer plus rapidement les états datés. Cette simplification administrative pourrait, à terme, accélérer le déroulement des transactions immobilières et réduire les délais de vente.
Faut-il réaliser un diagnostic structurel de sa copropriété ?
L’arrêté du 22 août 2025 vient encadrer les professionnels chargés d’effectuer les diagnostics structurels des bâtiments d’habitat collectif. Cette mesure répond directement aux effondrements dramatiques d’immeubles survenus ces dernières années dans plusieurs villes françaises. L’objectif est clair : mieux prévenir les risques liés à la dégradation du bâti ancien.
Des zones prioritaires définies par les communes
Le diagnostic structurel ne s’impose pas encore sur l’ensemble du territoire. Les communes conservent la possibilité de désigner, via leur Plan Local d’Urbanisme (PLU), des zones prioritaires où ce diagnostic devient obligatoire. Ces secteurs correspondent généralement à des quartiers présentant des signes de fragilité structurelle ou un risque accru de dégradation du bâti.
Un rapport type et des exigences renforcées
L’arrêté établit un modèle national de rapport type, garantissant une méthodologie homogène sur tout le territoire. Ce document doit inclure :
- une analyse complète de la structure de l’immeuble,
- un historique des travaux réalisés,
- et des recommandations précises de sécurisation.
Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à effectuer ce diagnostic, afin d’assurer la fiabilité technique et juridique des conclusions. Par ailleurs, le plan pluriannuel de travaux (PPT), désormais obligatoire pour les copropriétés, peut tenir lieu de diagnostic structurel, à condition qu’il aborde l’ensemble des points exigés par l’arrêté.
Un délai de 18 mois pour se mettre en conformité
Les copropriétés situées dans les zones désignées disposent de 18 mois après la notification officielle pour transmettre leur diagnostic à la commune. En cas de non-respect de ce délai, la mairie peut faire réaliser le diagnostic d’office, aux frais de la copropriété.
Quelles actualités de la copropriété sur les bornes de recharge électrique ?
Une jurisprudence du tribunal de Paris du 11 septembre 2025 rappelle les limites du “droit à la prise”. En théorie, si l’assemblée générale ne se prononce pas dans les six mois suivant une demande, le copropriétaire peut installer sa borne de recharge d’office. Ce mécanisme vise à faciliter le développement des véhicules électriques.
Toutefois, la jurisprudence impose une limite importante. Lorsque l’installation nécessite de toucher à la structure de l’immeuble ou aux parties communes, une autorisation expresse de l’assemblée générale devient obligatoire. Le simple silence ne suffit plus.
Charles Bohbot explique : “Dans la vraie vie, il y a souvent une modification des parties communes si jamais on vient toucher à la structure de l’immeuble.”
Le tribunal de Paris a prononcé de lourdes condamnations contre des copropriétaires ayant installé leur borne sans autorisation malgré l’impact sur les parties communes. Ces actualités de la copropriété invitent à la prudence et au respect strict des procédures légales.
Le paiement tardif des charges évite-t-il les frais de justice ?
Une décision du 11 septembre 2025 (RG n° 24/01828) confirme que régler ses charges après assignation n’exonère pas des frais de procédure. Certains copropriétaires débiteurs attendent délibérément l’assignation pour régler leurs charges impayées. Ils espèrant ainsi éviter les frais de procédure engagés par le syndicat.
À cet effet, le tribunal rappelle fermement que le règlement tardif des charges n’exonère pas le copropriétaire des frais de procédure. Le syndicat a dû engager des dépenses pour contraindre le copropriétaire à payer. Il est légitime qu’il soit intégralement indemnisé.