Lorsqu’un bien immobilier comporte au minimum deux lots appartenant à deux propriétaires différents, sa mise en copropriété s’impose. À cet effet, il revient au propriétaire initial d’entreprendre les démarches nécessaires, strictement encadrées par la loi. À travers cet article, apprenez les conditions et les dispositifs nécessaires pour créer une copropriété.
Qu’est-ce qu’une mise en copropriété ou une création de copropriété ?
La mise en copropriété est une opération juridique qui transforme un bien immobilier unique en plusieurs lots distincts. Chaque lot appartient alors à un propriétaire différent qui devient un “copropriétaire”. Chaque propriétaire d’un lot devient alors un “copropriétaire”. Les lots se divisent en deux catégories :
- Parties privatives, telles que des appartements ou des bureaux,
- Parties communes, comme des couloirs, des escaliers ou des jardins.
Ainsi, chaque bien du bâtiment collectif comprend une surface privative et une quote-part de parties communes. De cette façon, la mise en copropriété forme une communauté de propriétaires. Ils partagent les responsabilités et les avantages liés à la propriété et à l’entretien de l’immeuble.
Cependant, la création d’une copropriété va au-delà d’une simple démarche administrative. En réalité, c’est une aventure collective qui commence bien avant la signature des actes et se prolonge bien après. Elle représente une vision moderne de la propriété et de la cohabitation. Et, tout en respectant les règles établies, elle assure l’harmonie et l’équité au sein de la communauté des propriétaires.
Quelles sont les motivations derrière la mise en copropriété ?
La mise en copropriété est souvent une étape clé dans la gestion et la valorisation d’un bien immobilier. Mais, elle se révèle indispensable dans plusieurs scénarios. C’est une démarche complexe nécessitant l’assistance d’un expert dans ce domaine. Voici quelques situations typiques où la mise en copropriété est fortement recommandée :
La subdivision d’une grande propriété existante
Lorsque survient un héritage, notamment hors du régime de l’indivision, la subdivision d’une grande propriété en plusieurs lots distincts devient une nécessité. En effet, cette démarche facilite la répartition du bien immobilier entre les différents héritiers.
Toutefois, cette opération n’est envisageable que si les parties communes de la propriété peuvent être aménagées de façon adéquate. Par ailleurs, un propriétaire d’une vaste résidence individuelle peut choisir de la subdiviser pour en faciliter la vente. Ainsi, il pourra diviser son bien en plusieurs unités d’habitation, rendant chaque unité plus accessible et attractive sur le marché immobilier.
La vente en lots d’un immeuble neuf
Les promoteurs immobiliers recourent à la mise en copropriété de leurs immeubles neufs d’habitation. L’objectif est alors de proposer aux acquéreurs des appartements ou des studios en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement).
Dans le contexte d’une vente immobilière en l’état futur d’achèvement, aussi appelée VEFA ou achat sur plan, l’acheteur acquiert un bien immobilier avant qu’il ne soit achevé. Cela signifie qu’au moment de la signature du contrat, le bien n’est pas encore construit ou est en cours de construction. Contrairement à une vente traditionnelle, le vendeur (promoteur immobilier) transfère immédiatement au moment de la signature du contrat les droits de propriété sur le terrain et la future construction à l’acheteur.
Toutefois, le régime de copropriété s’applique uniquement quand l’immeuble est achevé. En d’autres termes, il s’applique dès que l’immeuble est habitable. Ainsi, votre responsabilité pour les charges de copropriété commence à partir de la date d’achèvement du programme immobilier neuf.
Le choix de l’habitat participatif
De même, créer une copropriété est indispensable en matière d’habitat participatif. Puisque cette démarche collaborative débute dès la phase de conception de l’immeuble. En cela, plusieurs personnes se regroupent pour élaborer un projet immobilier commun qui répond à leurs besoins spécifiques et reflète leurs principes de vie.
Chaque habitant bénéficie alors d’espaces privatifs tout en ayant accès à des espaces communs partagés comme un jardin, une buanderie, une salle de fêtes ou une salle de sport. La mise en copropriété assure ainsi une gestion équitable et organisée des espaces partagés.
Un projet immobilier via une SCI (Société Civile Immobilière)
Les associés d’une SCI envisageant de construire une propriété composée de deux logements ou plus peuvent également opter pour la mise en copropriété. De même, une SCI peut détenir la propriété d’un ou de plusieurs lots au sein d’un immeuble en copropriété. De ce fait, elle se positionne en tant que copropriétaire et adhère au syndicat des copropriétaires. Toutefois, il est important de noter que, en sa qualité de personne morale, la “SCI copropriétaire” est soumise à certaines règles spécifiques.
Chacun de ces scénarios souligne l’importance et l’utilité de la mise en copropriété dans le secteur immobilier. Elle offre un cadre juridique clair et structuré, permettant une gestion collective efficace et une valorisation optimale du bien immobilier.
Mise en copropriété : les conditions et obligations à respecter
Avant d’entamer le processus de mise en copropriété, il est impératif de s’assurer que certaines conditions sont remplies. Ces prérequis sont essentiels pour garantir une mise en copropriété réussie et conforme aux exigences légales.
Une vérification de l’état du bien immobilier
Le bien immobilier doit être en bon état. En l’occurrence, une inspection technique permet de s’assurer qu’il n’est ni défectueux, ni insalubre, ni dangereux pour ses occupants. Cette inspection englobe divers aspects tels que la structure du bâtiment, les installations électriques et de plomberie, etc.
Par ailleurs, le bien doit être conforme aux normes de décence et d’habitabilité stipulées par la loi. De plus, il ne doit pas faire l’objet d’un arrêté de péril ou d’une interdiction d’habiter.
De plus, l’immeuble devra comporter pour le quart au moins de sa superficie totale des logements classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. En effet, ces logements ne présentent plus les critères élémentaires d’habitabilité.
Notons que la création d’une copropriété sera écartée pour un immeuble bâti avant 1948 n’ayant subi ni un diagnostic amiante ni un diagnostic de saturnisme. De même, cette interdiction s’applique lorsque la division en lots de vieilles propriétés entraîne la création des logements inadaptés. C’est-à-dire la constitution d’espaces de vie inférieurs à une superficie de 14 m² et un volume habitable inférieur à 33 m².
Enfin, l’immeuble doit disposer d’un système d’évacuation des eaux usées, d’un système d’alimentation en eau potable et d’un accès à la fourniture de courant électrique.
Mise en copropriété : la réalisation de l’état descriptif de division
Dans un premier temps, la tâche d’élaborer le plan de découpage est confiée à un géomètre-expert. Ce professionnel procède à la mesure des surfaces des lots, puis dessine le plan intérieur, mettant en lumière les parties privatives et les parties communes. Un code couleur est employé pour les distinguer clairement.

En effet, le propriétaire doit faire établir l’état descriptif de division pour créer une copropriété. Aussi, il fera appel à un géomètre qui devra déterminer, mesurer et localiser chaque lot de l’immeuble. Notamment, les lots des parties privatives : appartements, studios, loggias, balcons, etc. Ensuite, il définira les lots des parties communes : couloirs, escaliers, locaux à poubelles, etc. Enfin, des lots des parties communes, pourront être attribués en jouissance exclusive, à certains des copropriétaires.
> Consultez notre article sur : “Tout savoir sur l’état descriptif de division”
Après l’identification des lots, le géomètre attribue à chaque lot un numéro d’identification. En effet, sa mission est de fournir une description précise du lot. Il en détermine sa superficie, sa consistance, sa position dans le bâtiment et sa destination (habitation, bureau ou commerce). Notons que l’on affecte à chaque lot, une quote-part des parties communes, exprimée en tantièmes ou en millièmes. C’est à partir de cette quote-part que s’opère la répartition des charges communes entre les copropriétaires.
Mise en copropriété : l’établissement du règlement
Suite à l’opération de division de l’immeuble, le notaire, l’avocat ou le géomètre seront amenés à collaborer pour rédiger le règlement de copropriété. De quoi s’agit-il ? Le règlement de copropriété est un document contractuel accepté par tous les copropriétaires d’un immeuble. C’est une sorte de charte commune indiquant les droits et les devoirs de chaque propriétaire. Par conséquent, on devra s’y référer à tout moment de la vie de la copropriété.
En raison des précisions apportées sur la définition des parties privatives et des parties communes. Mais aussi, sur la destination, l’usage, la gestion ainsi que la contribution aux charges communes des copropriétaires.
De sorte que ces deux documents, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, doivent obligatoirement être publiés par le notaire au Fichier Immobilier (ancienne conservation des hypothèques). Puisque c’est cette publicité qui va rendre opposables ces documents. Par la suite, une décision de l’assemblée générale des copropriétaires autorisera la modification de ces documents.
À savoir, les futurs acheteurs ne peuvent pas remettre en cause un acte opposable. Par ailleurs, cette publicité foncière implique également l’immatriculation au registre national des copropriétés.
Les diagnostics immobiliers obligatoires pour la mise en copropriété d’un immeuble
La mise en copropriété d’un immeuble implique la réalisation d’une série de diagnostics immobiliers. Ces derniers sont essentiels pour assurer la sécurité et le bien-être des futurs copropriétaires. Ils permettent également de se conformer aux diverses obligations légales. Voici un aperçu des diagnostics clés et leur importance dans la mise en copropriété.
> Consultez notre article sur : “Quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires en copropriété ?”
Diagnostic plomb ou constat de risque d’exposition au plomb (CREP)
La mise en copropriété d’un immeuble construit avant 1949 requiert impérativement un diagnostic plomb, ou constat de risque d’exposition au plomb (CREP). Cette évaluation permet de déterminer la présence éventuelle de plomb dans les différents lots et dans les parties communes.
Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, une concentration excessive de plomb est un risque sanitaire majeur pour les occupants. Dans ce cas, les copropriétaires doivent engager des travaux de déplombage ou de réparation des revêtements protecteurs.
Diagnostic Amiante
Pour les immeubles construits avant 1997, le diagnostic amiante est un passage obligé avant la mise en copropriété. L’objectif est de détecter la présence éventuelle de particules amiantées. En effet, l’exposition à l’amiante peut engendrer des maladies respiratoires graves. En cas de détection d’amiante, une démarche de désamiantage est exigée. Ces travaux sont alors suivis d’un nouveau diagnostic pour garantir une concentration dans l’air ambiant inférieure à 5 fibres par litre, conformément aux normes de sécurité.
Mise en oeuvre du Diagnostic Technique Global (DTG)
Depuis le 1er janvier 2017, le Diagnostic Technique Global (DTG) est de mise pour les immeubles de plus de 10 ans en phase de mise en copropriété. Ainsi, il remplace l’ancien “diagnostic technique préalable à la mise en copropriété” qui s’adressait aux immeubles de plus de 15 ans.
À cet effet, le DTG permet de réaliser certaines opérations pour faire un état des lieux complets de l’immeuble, cela consiste à :
- analyser l’état apparent des parties et équipements communs ;
- évaluer les éventuelles améliorations à effectuer sur l’immeuble ;
- effectuer un audit énergétique du bâtiment ;
- vérifier la situation du syndicat des copropriétaires ;
- évaluer les travaux d’entretien et de conservation de l’immeuble ;
- estimer le coût prévisionnel de ces travaux.
En effet, ce diagnostic est un tour d’horizon exhaustif pour une évaluation complète de l’immeuble, des équipements communs aux travaux d’entretien nécessaires. Le propriétaire doit présenter le rapport de ce DTG à la première assemblée générale des copropriétaires. À l’appui de ce document, les futurs acquéreurs s’informeront sur l’état de l’immeuble et sur ses éléments de sécurité et d’équipements communs.
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) collectif
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) collectif est incontournable pour les copropriétés de plus de 50 lots dotées d’un système de chauffage et/ou de refroidissement collectif. Ce diagnostic est un levier pour une mise en copropriété respectueuse de l’environnement et économiquement viable.
> Consultez notre article sur : “DPE collectif : champ d’application de la loi Climat et Résilience”
Mise en copropriété : la désignation d’un syndic
Le placement d’un immeuble en copropriété entraîne automatiquement l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. À cet égard, rappelons que la copropriété ne commence vraiment que lorsque la première vente d’un lot a lieu. Rappelons que le syndic de copropriété a pour rôle de représenter les copropriétaires. Il est normalement élu par le syndicat des copropriétaires à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. C’est-à-dire à la majorité de tous les copropriétaires lors d’une assemblée générale.
> Consultez notre article sur : “Syndic de copropriété : désignation dans une copropriété neuve”
Nomination d’un syndic provisoire dans une copropriété neuve
La mise en copropriété, particulièrement dans le cadre d’un immeuble neuf, est un processus encadré par la loi qui requiert une gestion rigoureuse et anticipée. L’une des étapes cruciales dans ce processus est la nomination d’un syndic provisoire.
Ainsi, la loi confère au promoteur la responsabilité de nommer un syndic provisoire. Cette démarche est particulièrement pertinente lors d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). La nomination d’un syndic provisoire est donc une réponse légale à l’interdiction formelle d’une copropriété sans syndic, assurant ainsi une gestion ordonnée dès l’inauguration de la copropriété.
À cet effet, le syndic provisoire est le pilier administratif et financier de la mise en copropriété jusqu’à la tenue de la première assemblée générale. Son rôle englobe la gestion quotidienne de l’immeuble. L’importance de cette phase transitionnelle réside dans la préparation méthodique de l’assemblée générale, moment charnière pour l’élection d’un syndic de copropriété par le syndicat des copropriétaires. Cette étape, bien orchestrée, assure la continuité dans la gestion de la copropriété.
Par ailleurs, le syndic provisoire endosse également la casquette de représentant légal du syndicat des copropriétaires. Par exemple, il est présent le jour de la livraison des parties communes. Sa mission est alors d’effectuer la levée des réserves, une étape critique pour défendre les intérêts de la copropriété face au promoteur ou en justice. Cette représentation légale est une garantie pour les copropriétaires. En effet, elle assure que leurs intérêts sont protégés dès les prémices de la mise en copropriété.
Choix à l’amiable du syndic provisoire dans un immeuble existant
Dans le cadre d’une mise en copropriété, le syndic provisoire peut être choisi à l’amiable parmi les futurs copropriétaires. Notamment lorsqu’il s’agit d’héritiers d’un partage successoral. Cette désignation amiable est une première étape qui instaure un climat de confiance et de collaboration entre les futurs copropriétaires. Elle jette les bases d’une gestion concertée, inaugurant ainsi le périple de la mise en copropriété.
De fait, le syndic provisoire a la responsabilité de convoquer la première assemblée générale des copropriétaires. Il fixe seul l’ordre du jour, car le conseil syndical n’est pas encore constitué pour l’assister et contrôler son action. Cette première AG est donc un moment charnière dans la mise en copropriété. Puisqu’elle marque le début de la gestion collective. À l’issue de cette réunion, un nouveau syndic peut être nommé ou le mandat du syndic provisoire peut être renouvelé, selon le consensus des copropriétaires.
La première assemblée générale est un rendez-vous décisif pour la mise en copropriété. Elle permet notamment :
- D’établir un budget prévisionnel,
- D’élire les membres du conseil syndical,
- De fixer le seuil de consultation et de mise en concurrence pour les travaux.
Si l’immeuble a récemment été divisé et rénové, le vote pour des travaux sur les parties communes pourrait ne pas être nécessaire, simplifiant ainsi les décisions initiales. Les règles de majorité à suivre sont celles indiquées au règlement de copropriété. Ces premières résolutions, adoptées en assemblée, dessinent les contours de la vie en copropriété et jettent les fondations d’une gestion collective efficace et harmonieuse. L’aventure de la copropriété peut commencer !




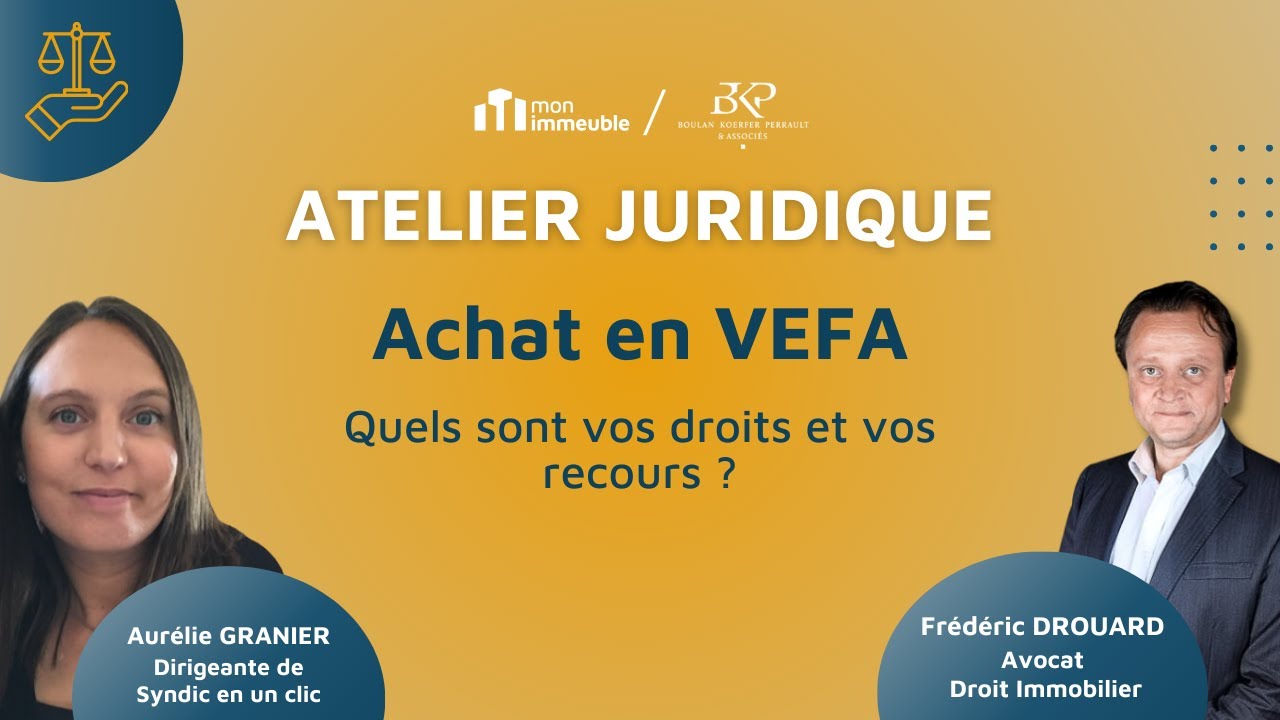
Bonjour,
Les frais de création d’une copropriété sont ils déductibles des impots fonciers?
Cordialement
Retour de ping : Création d’une copropriété : les règles spécifiques aux biens immobiliers neufs ou anciens - Construction Maison Toulouse
Retour de ping : Est-ce un bon choix d'investir dans la copropriété en 2024 ? - investissement-avenir.fr
Retour de ping : Comment rentabiliser une copropriété en limitant les coûts des charges et du fonctionnement ? - investissement-rentable.eu
Retour de ping : Organiser une copropriété : Conseils et procédures - Achat Loire
Retour de ping : Créer une copropriété : Guide pratique - A coup sûr immobilier
Retour de ping : Tout savoir sur les dernières informations sur la copropriété pour 2024 - Bensimonleblog