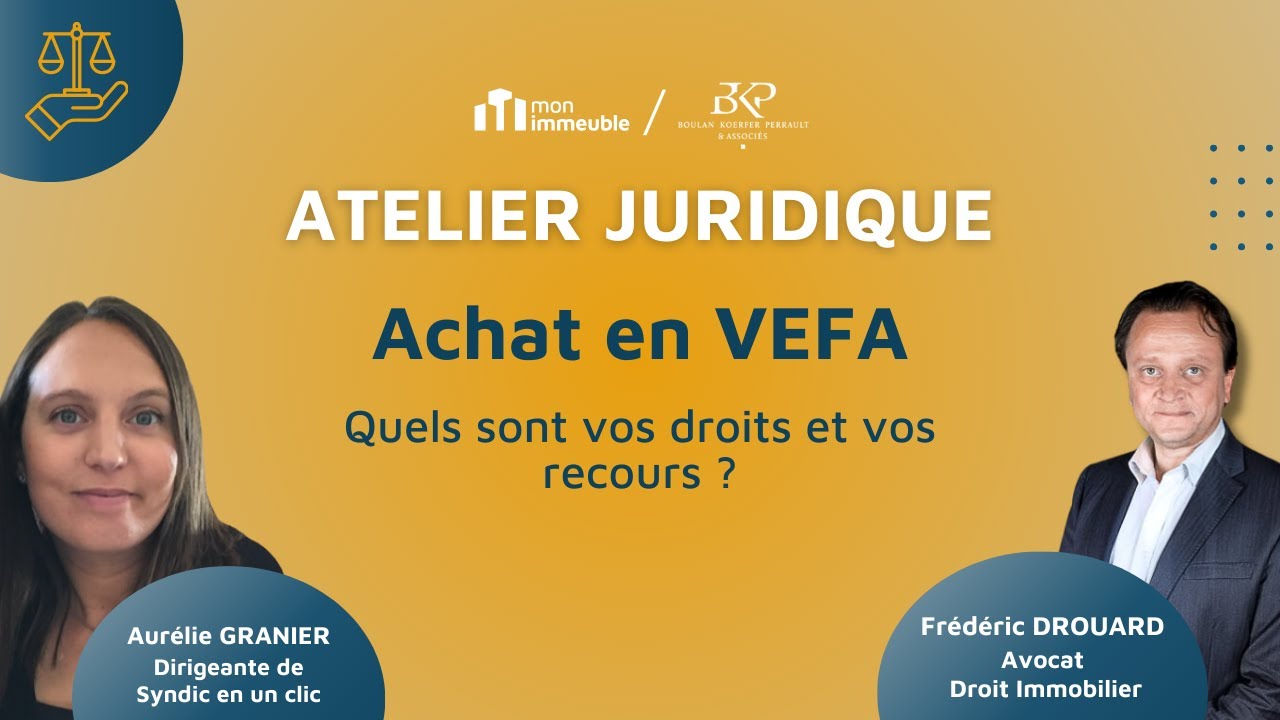Soixante ans après la loi de 1965, le cadre juridique montre ses limites. La CLCV tire la sonnette d’alarme. Elle propose 41 mesures concrètes pour moderniser la gestion des immeubles collectifs. Les problèmes s’accumulent : absences en assemblée générale, impayés, exclusion des locataires. Résultat : des copropriétés fragilisées, parfois à la dérive. La réforme de la copropriété doit répondre à trois urgences : renforcer la démocratie interne, stabiliser les finances, et adapter la gouvernance aux réalités d’aujourd’hui. Comment redonner souffle à la gestion de copropriété ?
Sommaire :
- Pourquoi cette réforme de la copropriété est-elle si urgente en 2025 ?
- Comment combattre l’absentéisme en assemblée générale ?
- Quels outils financiers pour prévenir les impayés ?
- Comment intégrer les locataires dans la gestion ?
- Quelles évolutions pour les syndics professionnels ?
- Pourquoi codifier le droit de la copropriété ?
Pourquoi cette réforme de la copropriété est-elle si urgente en 2025 ?
Soixante ans après sa création, la loi de 1965 montre ses limites structurelles face à des défis sociologiques majeurs. L’absentéisme aux assemblées générales atteint parfois 70% dans certaines copropriétés, rendant quasi impossible l’adoption de décisions importantes. L’augmentation des impayés, l’exclusion systématique des locataires qui représentent souvent la majorité des occupants, et l’éparpillement du droit dans plus de 20 textes différents créent une situation ingérable. La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) constate que cette réforme de la copropriété est devenue incontournable pour éviter la multiplication des copropriétés en difficulté.
Comment combattre l’absentéisme en assemblée générale ?
Groupe de réflexion sur les majorités
L’absentéisme aux assemblées générales constitue le premier défi de cette réforme de la copropriété. Selon la CLCV, les règles de majorité qualifiée actuelles créent un cercle vicieux. Les travaux de mise en sécurité, qui nécessitaient originairement 776/1000ème pour être adoptés, se votent désormais à la simple majorité de l’article 24.
Plus les seuils baissent, plus les copropriétaires désertent les assemblées, estimant que “tout peut être décidé en leur absence”. Résultat : des décisions importantes prises par une minorité de participants représentant parfois seulement 300 ou 400/1000ème des voix.
C’est pourquoi la CLCV propose de créer un groupe de travail multidisciplinaire (juristes, syndics, représentants de copropriétaires) pour repenser fondamentalement le système. L’idée serait de ne comptabiliser que les voix des copropriétaires effectivement présents, représentés ou votant par correspondance, rétablissant ainsi les paliers de majorité disparus.
Limitation des passerelles automatiques
Depuis l’ordonnance de 2019, les passerelles de majorité s’appliquent automatiquement à toutes les résolutions relevant des articles 25 et 26, sans distinction. Certes, ce système automatique Simplifie la procédure. Mais, il supprime par là même toute nuance selon l’importance des décisions. Selon la CLCV, cette automaticité nivelle par le bas toutes les décisions. Faut-il vraiment la même facilité pour voter un simple ravalement que pour des travaux structurels lourds ?
La solution : un retour à un système plus sélectif. Ainsi, seules certaines résolutions prédéfinies bénéficieraient des passerelles automatiques. Par exemple : travaux d’entretien courant, désignation du syndic. Quant aux décisions majeures, elles, resteraient soumises à des seuils plus exigeants.
Simplification de l’article 26
L’article 26 impose une double condition cumulative :
- 50% des copropriétaires du syndicat
- ET 2/3 des voix de tous les copropriétaires
Prenons l’exemple d’une copropriété de 20 lots. Il faut minimum 10 copropriétaires présents ET que leurs voix totalisent au moins 667/1000ème. Si seuls 8 copropriétaires viennent (même s’ils représentent 800/1000ème), la majorité est impossible. Dans la plupart des copropriétés, cette majorité est devenue “arithmétiquement impossible”. Ce qui a alors conduit le législateur a multiplié les passerelles pour faire passer les travaux d’amélioration à des majorités plus faibles.
La solution CLCV ? Supprimer le critère du nombre de copropriétaires. Ne garder que celui des 2/3 des voix. Une exigence forte, mais réaliste. Cette approche s’inspire d’ailleurs du Rapport Braye de 2012 qui pointait déjà cette incohérence mathématique du système actuel. On redonnerait alors du sens à la majorité qualifiée, pour les grandes décisions : vente de parties communes, changement de destination, etc.
Vote électronique à distance
Depuis l’ordonnance de 2019, le vote par correspondance existe. Mais, il reste limité à un formulaire papier envoyé par voie postale ou électronique. Pour autant, les votes électroniques via extranet, bien que pratiques et largement utilisés, n’ont aucune base légale.
En effet, les textes ne prévoient le vote à distance que par formulaire écrit, créant une insécurité juridique pour les assemblées générales utilisant ces outils modernes. Ainsi, la réforme de la copropriété doit intégrer le vote électronique à distance tout en maintenant les garde-fous. Cette innovation technologique permettrait une participation accrue sans compromettre la qualité des débats.
Affichage obligatoire de l’ordre du jour
Aujourd’hui, seuls les copropriétaires reçoivent la convocation avec l’ordre du jour. Les locataires — souvent majoritaires dans l’immeuble — découvrent les décisions après coup. Et, encore, seulement si le procès-verbal abrégé est affiché… ce qui reste rare. Depuis 2000, la loi SRU impose cet affichage. Dans les faits, il est peu respecté. Résultat : les non-propriétaires sont exclus de la vie collective.

La CLCV propose une mesure simple : afficher l’ordre du jour avant l’assemblée générale. Objectif : informer tous les occupants, y compris les locataires. Mais, pas question de compromettre la vie privée. La solution ? Supprimer les données sensibles : noms des débiteurs, litiges en cours, informations financières personnelles. Une réforme équilibrée, qui concilie transparence et respect de la confidentialité.
Principales majorités dans la réforme

Quels outils financiers pour prévenir les impayés ?
Renforcer le fonds de travaux obligatoire
Cette réforme de la copropriété prévoit des sanctions administratives concrètes contre les syndicats négligents. La CLCV souhaite subordonner le versement d’aides publiques et de subventions ANAH à la mise en place effective du fonds de travaux. Actuellement, il n’est pas rare de voir des copropriétés qui refusent la mise en place de ce mécanisme.
Par ailleurs, le délai de mise en place passerait de dix à cinq ans après réception des travaux pour les immeubles neufs. On reviendrait alors à la rédaction initiale modifiée par la loi Climat & Résilience n°2021-1104 du 22 août 2021. En effet, l’idée initiale était de faire coïncider le début du fonds de travaux avec les premières dépenses importantes post-garanties (ravalement, réfection étanchéité, remplacement équipements…). Toutefois, un immeuble d’une quinzaine d’années pourrait tout à fait devoir réaliser des travaux importants. Or, le fonds de travaux n’ayant été mis en place que tardivement, il ne pourra pas remplir son office de préfinancement du chantier.
Pour les petites copropriétés, définies par l’article 41-8 comme ayant un budget prévisionnel inférieur à 15 000€, le taux de cotisation obligatoire monterait à 20% contre 5% actuellement. Toutefois, la proposition maintient l’alternative existante. Si la copropriété vote un plan pluriannuel de travaux, elle peut cotiser à 2,5% du montant des travaux planifiés au lieu des 20% du budget.
Actuellement, une copropriété avec un budget de 15 000€ ne collecte que 750€ par an avec le taux de 5%. Avec la réforme de la copropriété CLCV, cette même copropriété disposerait de 3 000€ annuels, permettant de constituer un véritable matelas financier préventif contre les appels de fonds exceptionnels qui mettent les copropriétaires en difficulté.

Encadrer strictement les frais de recouvrement
La réforme de la copropriété doit rétablir le plafonnement des frais de recouvrement, supprimé par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019. Le Conseil d’État avait pourtant confirmé dans son arrêt du 5 octobre 2016 que ce plafonnement concernait “tant les frais de recouvrement des charges impayées que les honoraires d’établissement de l’état daté”. La proposition de la CLCV consiste donc à rétablir dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la formulation qui permettait le plafonnement des frais de recouvrement. Elle s’inspire pour cela du décret existant pour l’état daté (montants de 180€ à 350€ selon le type de mutation).
Par ailleurs, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 serait étendu aux provisions du prochain exercice comptable, comme le préconisait déjà le Rapport Braye de 2012. Il s’agit d’une procédure d’urgence créée pour accélérer le recouvrement des impayés. À cet effet, elle permet au syndic de demander au juge l’exigibilité immédiate de toutes les provisions de l’exercice en cours, même si elles ne sont pas encore échues. Toutefois, cet article est très dissuasif en début d’exercice, mais son intérêt s’affaiblit en fin d’exercice budgétaire. Ce qui peut inciter certains copropriétaires à organiser des impayés chroniques sur cette période.
Enfin, cette réforme de la copropriété préconise un échéancier obligatoire pour toute dette supérieure à trois mois afin de protéger les copropriétaires défaillants. Nous devons absolument éviter que les impayés ponctuels se transforment en crises majeures par négligence ou opportunisme.
Comment intégrer les locataires dans la gestion ?
Créer un véritable statut des occupants
L’innovation majeure de cette réforme de la copropriété concerne l’inclusion démocratique des locataires dans la gouvernance résidentielle. Ainsi, un bailleur privé peut mandater son locataire représentant pour le représenter au conseil syndical. Sous réserve, néanmoins, d’obtenir l’accord de l’assemblée générale. Cette mesure s’inspire de l’ordonnance de 2019 qui autorise déjà les ascendants et descendants des copropriétaires à siéger au conseil syndical.
Le conseil des résidents, actuellement limité aux résidences-services par l’article 41-7 de la loi de 1965, s’étendrait à toutes les copropriétés. Son président deviendrait membre consultatif de plein droit du conseil syndical sans droit de vote. Ce qui crée un véritable pont démocratique entre occupants et instances décisionnelles.
“Ce modèle de consultation des occupants pourrait être élargi à l’ensemble des copropriétés. Il permet de concilier l’intégration et l’écoute des locataires ainsi que l’accès réservé à l’assemblée générale aux copropriétaires. Cette nouvelle instance pourrait notamment permettre aux résidents de s’exprimer sur des enjeux du quotidien, tels que la gestion des déchets ou l’aménagement de la copropriété aux mobilités durables, en adoptant une position qui serait par la suite présentée au conseil syndical et lors de l’assemblée générale.”
Faciliter l’accès aux informations
Par ailleurs, la réforme de la copropriété résoudrait l’impossibilité pratique pour les bailleurs de respecter l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur est tenu de tenir à la disposition du locataire les documents justifiant les charges locatives […] pendant un délai de six mois suivant l’envoi du décompte annuel de charges.
Selon l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ne peuvent consulter les pièces justificatives que : “pendant un délai qui ne peut être inférieur à une heure par tranche de vingt lots et par année civile, entre l’envoi de la convocation de l’assemblée générale et la tenue de cette assemblée”. Comment respecter une obligation de 6 mois avec un accès de 2 heures ?
Il serait donc judicieux de prévoir la possibilité pour le locataire de réclamer la communication, par voie dématérialisée, des différentes pièces justificatives des charges définies à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Ces propositions respectent scrupuleusement l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les locataires obtiendraient uniquement des droits consultatifs et informatifs, sans jamais empiéter sur le pouvoir décisionnel des copropriétaires. Ils pourraient représenter leur bailleur au conseil syndical sur mandat express, assister aux assemblées générales sans droit de vote, et disposer d’un conseil des résidents pour exprimer leurs préoccupations du quotidien. Cette participation s’inspire du modèle des résidences-services où elle fonctionne déjà parfaitement.
Quelles évolutions pour les syndics professionnels ?
Renforcer les obligations de transparence
Cette réforme de la copropriété impose aux syndics la rédaction d’un compte-rendu de gestion annexé à chaque convocation. Une enquête CLCV-Notre Temps de novembre 2021 révélait un écart de satisfaction de 17 points entre conseillers syndicaux (59%) et simples copropriétaires (42%), démontrant l’importance de l’information.
De même, l’organisation d’au moins une réunion annuelle avec le conseil syndical deviendrait obligatoire dans la gestion courante. Enfin, les appels de fonds suivraient un modèle type défini par arrêté ministériel pour améliorer leur compréhension.
Créer une commission de contrôle efficace
Dix ans après la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, la commission de contrôle promise n’existe toujours pas. Son pouvoir disciplinaire, drastiquement réduit par la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ne permet plus que la transmission d’avis à la DGCCRF.
La réforme de la copropriété de la CLCV exige sa création immédiate avec de véritables prérogatives : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercice. Cette instance paritaire profiterait autant aux copropriétaires qu’aux professionnels qui souhaitent assainir leur secteur et améliorer leur image publique.
Pourquoi codifier le droit de la copropriété ?
Un droit éparpillé dans plus de 20 textes
L’évolution de la loi du 10 juillet 1965 illustre parfaitement la nécessité de cette réforme de la copropriété. Le texte originel comportait 48 articles en 1965. Soixante ans plus tard, après une cinquantaine de modifications législatives, il en comporte désormais 160, soit une augmentation de 233% !

Le droit de la copropriété s’est éparpillé dans plus de 20 textes différents : loi initiale, dispositions dispersées dans le Code de la construction et de l’habitation, décrets autonomes multiples et arrêtés ministériels sectoriels. Résultat : un maquis juridique de plus de 400 articles que seuls les professionnels aguerris maîtrisent.
Une codification urgente
Malgré l’habilitation donnée par la loi ELAN en 2018 pour créer un Code de la copropriété avant novembre 2020, le gouvernement a laissé expirer ce délai sans agir. En 2021, la CLCV a donc pris les devants. Elle a publié son propre projet de codification, conforme aux recommandations de la Commission supérieure de codification.
Cette réforme de la copropriété par la codification représente un enjeu démocratique majeur. Il s’agit de rendre le droit de la copropriété lisible, compréhensible, et accessible à tous. Plus seulement aux initiés. Cette réforme de la copropriété est aussi une exigence constitutionnelle : garantir l’accessibilité et la sécurité juridique. La Commission d’enquête du Sénat appelle d’ailleurs à s’appuyer sur les travaux de la CLCV pour enfin avancer.
> Pour en savoir plus : Livre blanc- Les 60 ans de la loi du 10 juillet 1965 – Les réformes pour les années à venir.pdf