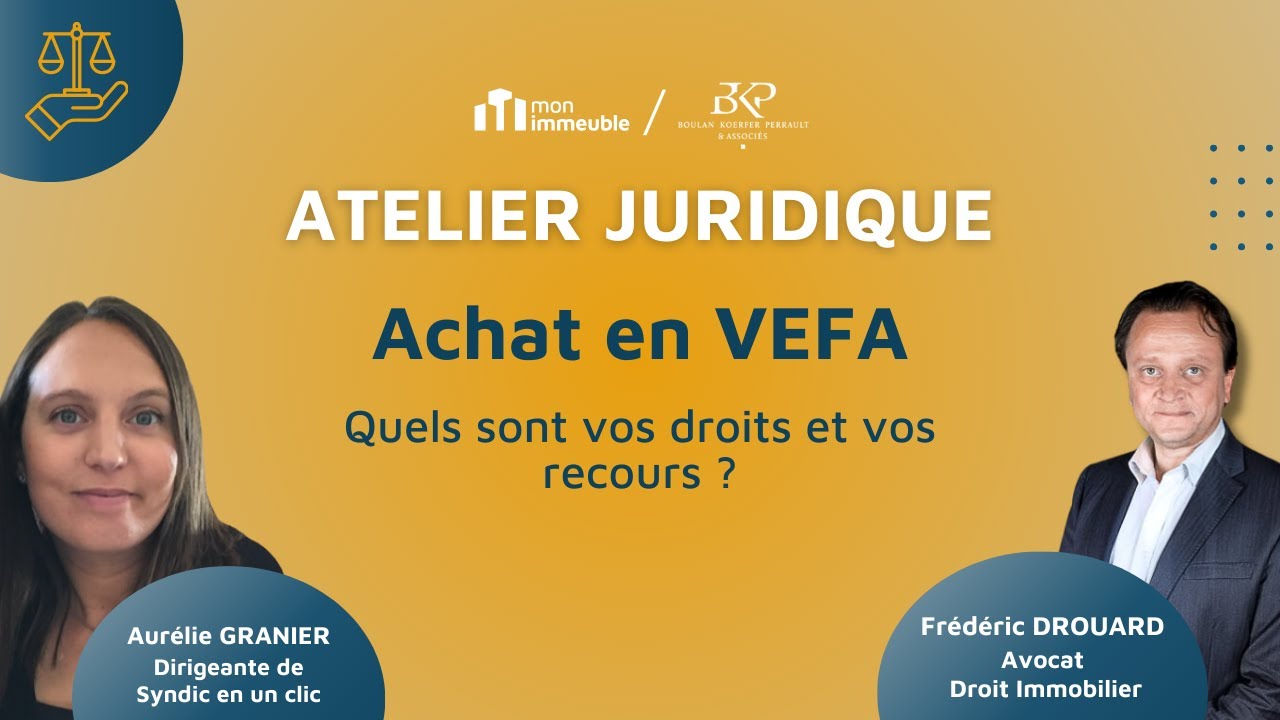La copropriété horizontale, aussi appelée “copropriété pavillonnaire”, est un régime juridique spécifique encore mal connu en France. Pourtant, selon l’Insee, en 2013, plus d’un quart (28,1 %) des logements en métropole étaient en copropriété horizontale. Ce guide a pour but d’expliquer en détail le fonctionnement particulier de la copropriété horizontale, ses avantages et inconvénients, ainsi que les possibilités pour en sortir. Vous trouverez toutes les informations essentielles, étayées par les textes de loi, pour bien comprendre ce régime contraignant et spécifique.
Sommaire :
- Qu’est-ce que la copropriété horizontale ?
- Quelles sont les différences entre une copropriété horizontale et un lotissement ?
- Comment fonctionne la copropriété horizontale ?
- Quels sont les contraintes et inconvénients de ce régime ?
- Comment sortir de la copropriété horizontale ?
- Conclusion
Qu’est-ce que la copropriété horizontale ?
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle définit dans son article 1 la copropriété comme “tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes”. Toutefois, la copropriété horizontale se distingue de la copropriété verticale (immeubles avec appartements) car elle est constituée d’un ensemble de maisons individuelles bâties sur un terrain commun.

Selon l’article 2 de la même loi, chaque lot se compose d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes. Dans une copropriété horizontale, les parties privatives sont les maisons. Tandis que les parties communes correspondent au terrain sur lequel elles sont construites.
Ainsi, les propriétaires possèdent pleinement leur maison, mais pas le terrain qui reste une partie commune. Ils disposent seulement d’un droit de jouissance sur leur parcelle, comme le précise l’article 3 de la loi de 1965. Ainsi, tout ce qui est bâti sur le terrain (voirie, espaces verts, équipements communs comme une piscine) fait partie intégrante des parties communes.
Quelles sont les différences entre une copropriété horizontale et un lotissement ?
Contrairement à une idée reçue, copropriété horizontale et lotissement ne sont pas synonymes. En effet, ils répondent à des régimes juridiques différents :
- En lotissement, le propriétaire d’une maison est pleinement propriétaire de sa parcelle, en application de l’article L442-1 du Code de l’urbanisme. Les parties communes se limitent donc aux équipements communs comme la voirie.
- En copropriété horizontale, le terrain est une partie commune. Les propriétaires des maisons n’ont qu’un droit de jouissance sur leur parcelle. Et, cela, conformément à l’article 3 de la loi de 1965. Tout le terrain appartient à la copropriété.
Notons que les promoteurs immobiliers optent souvent pour le régime de la copropriété horizontale. Ils le font quand ils ne peuvent pas obtenir l’autorisation administrative de diviser le terrain en parcelles distinctes. Ce régime permet alors de créer un lotissement malgré l’absence de division en parcelles.
Comment fonctionne la copropriété horizontale ?
La copropriété horizontale est soumise au même régime juridique que la copropriété verticale. À savoir la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ainsi, elle doit donc respecter les mêmes obligations légales :
- Établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division qui précise les parties privatives et communes de chaque lot (article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).
- Élire un syndic de copropriété, professionnel ou bénévole, chargé de la gestion et un conseil syndical représentant les copropriétaires (articles 17 et 21 de la loi de 1965).
- Tenir une assemblée générale au moins une fois par an pour voter les décisions relatives à l’administration de l’immeuble (article 14 de la loi de 1965).
Lors des AG, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix proportionnel à la valeur de son lot (parties privatives + quote-part de parties communes), comme le prévoit l’article 22 de la loi de 1965.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf celles listées à l’article 25 qui requièrent la majorité absolue de tous les copropriétaires (travaux d’amélioration, désignation/révocation du syndic…). Et, certaines décisions comme la modification de la répartition des charges de copropriété exigent même l’unanimité (article 26).
Enfin, depuis le 31 décembre 2016, la loi ALUR du 24 mars 2014 impose à toutes les copropriétés de s’immatriculer sur un registre national tenu par l’Anah (article L711-1 du Code de la construction et de l’habitation).
Quels sont les contraintes et inconvénients de ce régime ?
Le régime de la copropriété horizontale comporte de nombreuses contraintes pour les propriétaires :
Le droit de propriété sur sa parcelle est amoindri
Tout aménagement affectant les parties communes nécessite un vote à la majorité absolue de tous les copropriétaires en assemblée générale. Cela inclut des travaux comme percer une fenêtre, installer une piscine, repeindre sa façade ou surélever sa toiture. Cette exigence est précisée par l’article 25 de la loi de 1965.
De plus, les copropriétaires peuvent imposer des conditions ou des prescriptions. Par exemple, ils peuvent demander au copropriétaire de souscrire une assurance. Ils peuvent également exiger un contrôle par un architecte. Ces mesures visent à garantir la sécurité et la conformité des travaux.
Une autorisation administrative préalable
Outre l’accord de la copropriété, certains travaux requièrent aussi une autorisation administrative préalable. Selon leur importance, les travaux sont soumis à déclaration préalable ou à permis de construire. L’article R421-14 du Code de l’urbanisme liste les travaux concernés dans les zones couvertes par un PLU. Par exemple, la création d’une surface de plus de 40 m² nécessite un permis de construire. De même, pour une surface entre 20 et 40 m², un permis est requis si la surface totale de la maison dépasse 150 m² après travaux.
En dehors des zones PLU, un permis est requis dès 20 m², comme précisé par l’article R421-1. Pour les travaux en deçà de cette surface, une simple déclaration préalable suffit, selon l’article R421-17. Dès lors, ces exigences permettent de contrôler et réguler les constructions et aménagements.
Mais dans tous les cas, le copropriétaire doit obtenir les deux autorisations (copropriété + mairie) avant de démarrer ses travaux.
Des charges collectives plus élevées
Les charges collectives sont souvent conséquentes dans une copropriété horizontale. Les parties communes y sont très étendues. Par exemple, elles incluent la voirie, les réseaux, et les espaces verts. De plus, elles comprennent des équipements communs comme une piscine. De fait, cette étendue des parties communes explique le montant élevé des charges. Même si le jardin est à usage privatif, son entretien incombe au copropriétaire. Aussi, pour réduire les charges, certaines copropriétés horizontales décident de rétrocéder la voirie et les réseaux à la commune.
Comment sortir de la copropriété horizontale ?
Face aux nombreuses contraintes de ce régime, il n’est pas rare que des copropriétaires cherchent à en sortir, soit de façon collective en changeant le statut, soit de manière individuelle en “détachant” leur lot.
Plusieurs options existent :
La copropriété peut décider de céder à titre gracieux la voirie et les espaces communs à la commune. Celle-ci assumera ensuite l’entretien. Notons que cette décision doit être votée à la majorité absolue de l’article 25 lors d’une AG. Pour autant, si cela permet de faire baisser les charges, la copropriété perd en contrepartie la maîtrise de ces espaces qui deviennent publics.
Un copropriétaire peut aussi demander à faire sortir son lot de la copropriété pour en récupérer la pleine propriété, y compris du terrain. C’est l’article 28 de la loi de 1965 qui encadre cette scission. Mais, cela nécessite également l’accord de l’AG à la majorité absolue. Notons que cette scission est réalisable si le lot est divisible, car situé en bordure. De plus, si le départ du copropriétaire alourdit les charges des autres, une contrepartie financière pourra lui être demandée.
Enfin, la copropriété horizontale peut décider de se transformer globalement en lotissement par un vote en AG. Dans ce cas, un géomètre-expert intervient pour définir et borner les parcelles de chaque lot. Le fonctionnement reste assez proche avec des espaces communs, mais le statut offre plus de souplesse pour les propriétaires. Une association syndicale libre (ASL) remplace alors le syndic pour la gestion des parties communes, conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004.
Conclusion
Ce guide vous a permis de mieux cerner les spécificités de la copropriété horizontale, un régime juridique hybride qui concerne plus d’un quart des logements en France. Régie par la loi du 10 juillet 1965, elle se compose de maisons individuelles sur un terrain commun, avec un droit de propriété limité pour les copropriétaires. Avant d’acheter un pavillon en copropriété horizontale, il est essentiel d’en comprendre les contraintes au quotidien : nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété pour tous travaux extérieurs, entretien obligatoire du jardin, charges collectives élevées… Si ces aspects vous rebutent, préférez une maison en lotissement ou individuelle classique.
Si vous êtes déjà propriétaire en copropriété horizontale, plusieurs options existent pour en sortir : cession de la voirie à la commune, scission de votre lot après accord de l’AG ou passage collectif en lotissement. Faites-vous conseiller par un notaire ou un avocat spécialisé pour choisir la meilleure solution. En effet, l’achat d’une maison est un projet d’envergure qui engage sur le long terme. Avec les informations de ce guide, vous pouvez désormais faire votre choix en toute connaissance de cause, en soupesant les avantages et inconvénients de la copropriété horizontale.