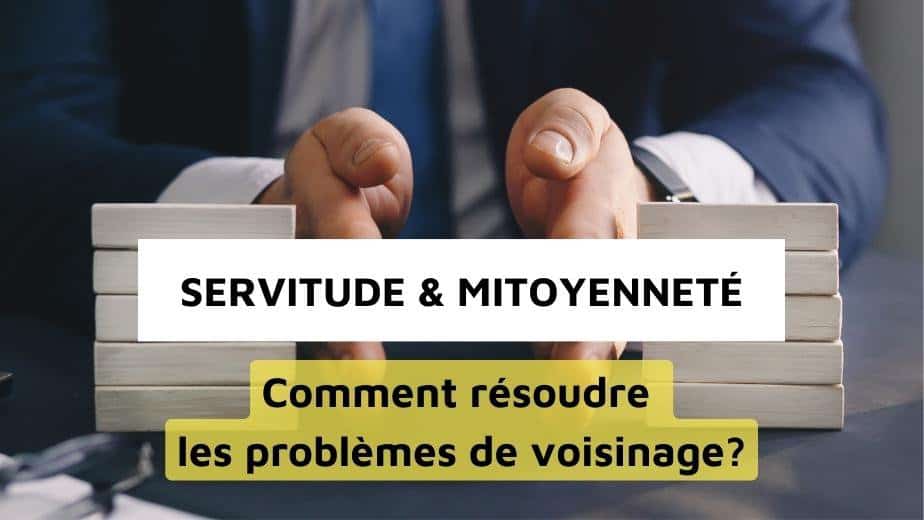Les problèmes de voisinage peuvent souvent être résolus grâce à l’utilisation de servitudes. En effet, les servitudes permettent d’obtenir l’usage ou l’utilité d’un bien immobilier appartenant à un autre propriétaire. Comme un droit de passage pour accéder à une parcelle enclavée ou une servitude de vue. Ainsi, il importe lorsque l’on est confronté à une servitude d’en déterminer la nature et le régime juridique.
Sommaire :
- Les caractéristiques des servitudes pour résoudre les problèmes de voisinage
- Le rôle du notaire dans la résolution des problèmes de voisinage via les servitudes
- La création des servitudes pour résoudre les problèmes de voisinage
- L’exercice des servitudes
- L’extinction des servitudes
- Quelques exemples de résolutions de problèmes de voisinage
Les caractéristiques des servitudes pour résoudre les problèmes de voisinage
Il existe des servitudes légales ou conventionnelles de droit privé et des servitudes de droit public. Exemples de servitude d’utilité publique : accès des piétons aux plages, servitudes aéronautiques, servitudes radioélectriques…
Trois grandes catégories de servitudes
- les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux. Exemples : écoulement des eaux, bornage, etc. ;
- les servitudes imposées par la loi qui peuvent être des servitudes d’utilité publique ou d’intérêt privé. Exemples : plantations et constructions, servitudes de vue ;
- les servitudes établies par le fait de l’homme. C’est-à-dire celles qui sont établies par des conventions entre propriétaires. Exemples : servitude de passage, interdiction de construire, etc. Notons que ces servitudes ne sont opposables à l’acquéreur d’un bien que si elles sont mentionnées dans le titre de propriété ou si elles ont fait l’objet de la formalité de publicité foncière.
Les servitudes peuvent présenter des caractères différents et se combiner entre elles
- Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans intervention actuelle de l’homme. Exemple : servitude de ne pas construire à tel endroit, etc. ;
- Les servitudes discontinues nécessitent l’intervention actuelle de l’homme pour être exercées. Exemples : servitude de passage, de puisage, etc. ;
- Les servitudes apparentes sont visibles. Exemple : conduite d’eau, etc. ;
- Les servitudes non apparentes ou occultes sont invisibles. Exemple : interdiction de construire, etc. ;
- Les servitudes sont dites actives (pour le fonds bénéficiaire), ou dites passives (pour le fonds qui les supporte).
Le rôle du notaire dans la résolution des problèmes de voisinage via les servitudes
Au moment de l’établissement de la servitude
La servitude, comme le droit de propriété dont elle est l’accessoire, est perpétuelle. Cependant, il est possible pour les parties concernées de convenir d’une durée temporaire pour la servitude par le biais d’une convention.
Pour être valable, toute constitution ou modification de servitude doit être réalisée par un acte authentique. Ce dernier doit être publié afin de produire des effets envers les tiers, notamment les propriétaires ultérieurs.
Ainsi, l’acte notarié aura pour objet :
- de fixer l’assiette de la servitude. En effet, il prévoira le tracé de l’itinéraire en cas de servitude de passage,
- de régler l’indemnité éventuellement due. De fait, il peut s’agir soit d’un capital versé en une fois, soit d’une redevance périodique.
Au moment de la vente du bien immobilier qui bénéficie de la servitude ou qui la supporte
Les problèmes de voisinage peuvent souvent être résolus grâce à l’utilisation de servitudes. La servitude est un droit réel immobilier qui est accessoire au droit de propriété. Il est important de noter que la servitude est attachée au bien et non à la personne du propriétaire. Ainsi, si le bien change de propriétaire, il est transmis avec la servitude. Il est impossible de disposer (vendre) du bien immobilier indépendamment de la servitude.
C’est pourquoi, acquéreur du bien immobilier doit être informé d’éventuelles servitudes grevant le bien concerné. En effet, l’existence de la servitude peut occasionner un préjudice au propriétaire du fonds servant (exemple : servitude de passage). Et, en principe, ces servitudes déprécient la valeur d’un bien immobilier. Il est donc nécessaire que l’acquéreur en ait connaissance lors de la vente.
Ainsi, il appartient au vendeur, dans le contrat de vente, de déclarer les servitudes grevant le bien vendu. Le vendeur doit non seulement déclarer les servitudes conventionnelles, mais également les servitudes non apparentes ou « occultes » dont il a connaissance. Le cas échéant, il encourt une peine de résiliation du contrat ou de dommages et intérêts au profit de l’acquéreur.
Afin de satisfaire à cette obligation lors de la vente, le notaire consultera les titres antérieurs. De cette façon, il identifiera les servitudes pouvant grever le bien. Il demandera, notamment, un certificat d’urbanisme faisant apparaître d’éventuelles servitudes d’urbanisme (non apparentes).
La création des servitudes pour résoudre les problèmes de voisinage
Les servitudes établies par l’homme
Il n’est pas question ici des servitudes légales créées par la loi. En effet, nous évoquons celles établies par convention. Toutes les servitudes peuvent être établies, aménagées ou modifiées par une convention. C’est-à-dire qu’un acte juridique écrit (convention ou jugement) fera intervenir le propriétaire du bien qui supporte la servitude. Rappelons que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par convention.
Cette convention peut être :
- un acte authentique, reçu et signé par un notaire. Il sera alors publié au bureau des hypothèques ;
- un titre recognitif. Autrement dit, un acte par lequel on reconnaît et l’on ratifie un droit ou une obligation antérieure en rappelant le titre constitutif dont l’original est perdu.
L’acquisition par prescription
Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent s’acquérir par la prescription trentenaire (exemple : servitude de vue). Toutefois, cette possession doit être :
- continue et non interrompue,
- paisible,
- publique,
- non équivoque (ne permettant pas de mettre en doute la qualité de propriétaire),
- à titre de propriétaire (article 2229 du Code civil).
Celui qui revendique l’acquisition par prescription doit rapporter la preuve de la possession trentenaire. Ainsi, il devra présenter un acte de notoriété établi par un notaire et donnant lieu à publicité foncière.
La destination du père de famille
La destination du père de famille existe lorsqu’il est prouvé que des fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire. De sorte que c’est la division du terrain qui a nécessairement entraîné la création de servitudes. Dans ce cas, un titre n’est pas nécessaire.
Les servitudes judiciaires
Citons, par exemple, le cas d’une délivrance d’un permis de construire. Celui-ci peut être soumis à la création, sur le bien voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou d’éviter de dépasser une certaine hauteur (servitudes de « cours communes »).
Or, ces servitudes peuvent être imposées par une décision judiciaire lorsque les propriétaires concernés ne parviennent pas à un accord. Dans ce cas, un jugement va trancher pour éviter des problèmes de voisinage durables.
L’exercice des servitudes
L’exercice des servitudes repose sur deux principes généraux.
Le caractère de droit réel de la servitude
Le propriétaire du fonds dominant a immédiatement le droit d’effectuer tous les travaux nécessaires sur le fonds servant pour l’exercice de la servitude. De son côté, le propriétaire du fonds servant doit les laisser faire. Excepté s’il a accepté de les effectuer dans le titre constitutif de la servitude.
La fixité de la servitude
Une fois acquise, la servitude ne peut pas se modifier dans son étendue. En cela, le propriétaire du fonds dominant ne doit rien faire qui l’aggrave. Quant au propriétaire du fonds servant, il ne doit rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou la rende plus incommode. Toutefois, une exception est prévue en cas d’une modification de la servitude imposée au propriétaire du fonds dominant.
L’extinction des servitudes
Les servitudes s’éteignent de trois manières :
- impossibilité de les utiliser. Par exemple : création d’un trottoir sur le fonds dominant rendant impossible l’usage d’un droit de passage ;
- réunion du fonds servant et du fonds dominant dans les mains d’un seul et même propriétaire ;
- non-usage de la servitude pendant 30 ans. Et, cela, que la servitude soit légale ou conventionnelle. Mais, la servitude légale de passage en cas d’enclave ne s’éteint pas par le non-usage. D’ailleurs, il en est de même pour la mitoyenneté.
De plus, les servitudes conventionnelles peuvent s’éteindre soit d’un commun accord entre les parties, soit par renonciation du propriétaire du fonds dominant. Dans ce dernier cas, le notaire doit établir un acte authentique et le publier au bureau des hypothèques. Ainsi, il devient opposable à l’acquéreur du bien au profit duquel la servitude était établie et aux tiers.
Quelques exemples de résolutions de problèmes de voisinage
Le droit de passage
En effet, ce droit peut résulter de la loi, en cas d’enclave (article 682 du Code civil). C’est le cas lorsque le propriétaire n’a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique pour accéder à sa propriété.
La fixation des modalités d’exercice du droit de passage se détermine, soit :
- d’un commun accord entre les parties,
- à défaut d’accord par le juge,
- par prescription.
Notons que le passage est pris du côté où le trajet est le plus court pour aller du fonds à la voie publique. De même, on le fixera dans l’endroit occasionnant le moins de dommages au propriétaire de la parcelle qui le supporte. Ce dernier perçoit une indemnité fixée à l’amiable ou par le juge.
Certes, cette servitude légale de passage peut s’éteindre. Cela peut se produire par des causes de droit commun ou tout simplement par la cessation de l’enclave. Prenons le cas d’une ouverture sur la voie publique ou de la réunion des deux lots. Toutefois, elle ne s’éteint jamais par le non-usage.
Enfin, le droit de passage peut résulter d’une convention. Dans ce cas, l’enclave n’est pas nécessaire. De fait, les modalités d’exercice du droit de passage résultent de la convention créant la servitude.
La cour commune
Cette servitude consiste en une interdiction formelle et perpétuelle pour les propriétaires. Ils ne pourront pas bâtir sur tout ou partie du sol joignant un ou plusieurs bâtiments. Dans d’autres cas, ils ne dépasseront pas une certaine hauteur en construisant. En effet, cette servitude vise à aérer et éclairer les bâtiments qui l’entourent.
Les servitudes de cours communes résultent soit :
- d’un libre accord entre les propriétaires voisins. Dans ce cas, un acte authentique doit être dressé par un notaire et publié au bureau des hypothèques ;
- d’une exigence de l’administration. En application des règles d’urbanisme à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire.
À défaut d’accord entre les propriétaires, le Tribunal instituera la servitude et déterminera l’indemnité à verser au propriétaire du terrain qui la supporte. On se réfère alors aux articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
La mitoyenneté
Bien qu’évoquée dans le chapitre consacré aux servitudes dans le Code civil, la mitoyenneté n’est pas à proprement parler une servitude. Puisqu’elle ne restreint pas l’utilisation d’un bien. Toutefois, elle peut engendrer des problèmes de voisinage.
En effet, il s’agit d’un droit de propriété indivise qui porte sur la clôture séparant deux biens immobiliers contigus. Ils appartiennent à des propriétaires différents, la clôture étant établie sur la limite même des deux biens. Or, chaque propriétaire possède sur la clôture mitoyenne des droits égaux de jouissance.
La mitoyenneté s’acquiert de trois manières :
- par la construction à frais communs par les propriétaires voisins d’une clôture entre leurs terrains sur la ligne séparative ;
- par la prescription (voir la création des servitudes) ;
- la cession à un propriétaire voisin, de la mitoyenneté d’un mur édifié à ses frais et sur son propre terrain par un autre propriétaire.
Le mur mitoyen
Tout mur séparant des propriétés contiguës est présumé mitoyen. Ainsi, il est construit par deux propriétaires à frais communs sur la ligne séparative de leurs terrains. Cela vaut en l’absence de titre ou marques contraires susceptibles de détruire la présomption de mitoyenneté (article 654 du Code civil).
En effet, la preuve de la mitoyenneté d’un mur ne pose pas de difficulté lorsqu’il existe un titre de propriété. À défaut de titre ou en cas de silence de l’acte à ce sujet, les problèmes de voisinage peuvent survenir. Puisque la preuve de la mitoyenneté ne suffit pas toujours.
En effet, cette preuve s’établit selon des signes extérieurs sur le mur prévus par la loi conformément à l’article 653 et suivants du Code civil. Pour autant, les présomptions légales de mitoyenneté peuvent être détruites par un titre. Ce sera le cas également par une prescription trentenaire ou un témoignage.
Concrètement, la règle veut que chaque propriétaire puisse utiliser le mur à condition de respecter les droits de son voisin. Ainsi, chacun doit veiller à son entretien et à sa conservation et éviter tout acte de nature à causer un dommage au mur.