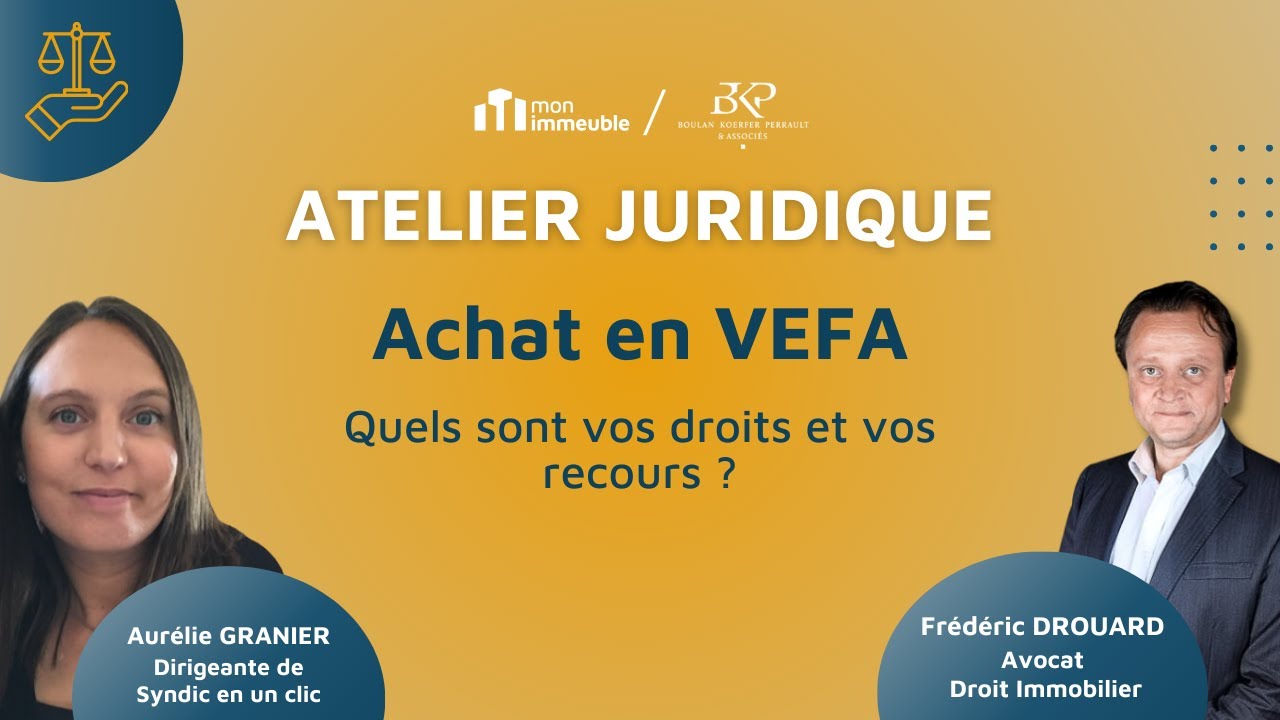Vous souhaitez rester informé des dernières évolutions réglementaires en matière de copropriété ? Ne manquez pas le dernier épisode de notre émission “Podcast Copro”. En 20 minutes, Isabelle Dahan et Charles Bohbot, avocat en droit immobilier, vous proposent une analyse claire et concise des récentes informations juridiques de la copropriété. Que vous soyez syndic, copropriétaire ou simplement intéressé par le sujet, cette émission est faite pour vous. Restez à l’écoute pour bénéficier de conseils avisés et mieux comprendre le cadre légal dans lequel évoluent les copropriétés.
Sommaire :
- Informations juridiques de la copropriété : l’instabilité politique impacte les évolutions réglementaires
- Le salon SOLUCOP de Toulouse met en lumière les enjeux clés
- Le syndic d’intérêt collectif : un nouvel acteur prometteur, mais des zones d’ombre à éclaircir
- La saisie conservatoire : un outil efficace, mais à manier avec précaution
- Les autres informations juridiques à suivre de près
- Informations juridiques et veille jurisprudentielle de la copropriété
- Chute dramatique en copropriété : quelle responsabilité pour le syndicat ?
- Podcast Copro : votre rendez-vous pour décrypter les informations juridiques de la copropriété
Informations juridiques de la copropriété : l’instabilité politique impacte les évolutions réglementaires
La récente dissolution de l’Assemblée nationale, survenue le dimanche 14 mai 2024, jette un voile d’incertitude sur l’avenir des réformes en cours concernant les copropriétés. Comme le souligne Charles Bohbot, avocat associé du cabinet BJA, “ Quand politiquement les affaires deviennent instables, on peut se demander s’il y aura une poursuite de ce qui a été entrepris avec la loi habitat dégradé du 9 avril 2024. Des décrets d’applications sont en cours et on peut espérer que le calendrier là-dessus ne soit pas altéré.”
Les informations juridiques de la copropriété sont donc dans l’expectative. D’autant plus que l’on peut prévoir un changement de ministre du Logement prochainement.
“ On peut avant les Jeux Olympiques s’inquiéter sur le fait que les projecteurs soient mis sur notre pays. Au moment même où on devait être la Maison du Peuple qui éclaire, et bien le paysage s’assombrit”, commente Charles Bohbot.
Le salon SOLUCOP de Toulouse met en lumière les enjeux clés
Malgré ce contexte politique incertain, les professionnels de l’immobilier restent mobilisés pour décrypter et partager les informations juridiques de la copropriété. Le salon SOLUCOP qui s’est tenu à Toulouse en mai 2024 au stade toulousain en est un parfait exemple. Cet événement a été l’occasion d’aborder des sujets majeurs qui impactent la gestion des copropriétés.
Parmi les temps forts, une conférence animée par Charles Bohbot et Florence JAMMES (membre du GRECCO et de la CNEC) a connu un vif succès. Tous deux ont proposé un panorama complet des dernières évolutions légales et jurisprudentielles. La loi “Habitat dégradé” du 9 avril 2024 était au cœur des débats, avec des focus sur des mesures phares comme :
- la saisie conservatoire des provisions de charges,
- l’emprunt collectif,
- ou encore le syndic d’intérêt collectif.
L’intervention de Martin Pavanello, cofondateur de “Mister IA” a aussi marqué les esprits. Il a alors démontré comment l’intelligence artificielle, à l’image de Chat GPT4, allait transformer les métiers de syndic et de gestionnaire de copropriété. À partir de cas d’usage concrets comme l’analyse automatisée d’un règlement de copropriété pour vérifier la conformité de certains équipements (ex : climatisation) ou la génération d’annonces immobilières optimisées.
Le syndic d’intérêt collectif : un nouvel acteur prometteur, mais des zones d’ombre à éclaircir
Introduit par l’article 22 de la loi “Habitat dégradé’ du 9 avril 2024, le syndic d’intérêt collectif suscite beaucoup d’attentes et d’espoirs pour venir en aide aux copropriétés en difficulté. Ce développement récent fait partie intégrante des informations juridiques de la copropriété que tout professionnel du secteur se doit de maîtriser.
Le syndic d’intérêt collectif est compétent pour intervenir dans deux types de copropriétés en difficulté :
- Les résidences qui dépassent un certain seuil d’impayés de charges,
- Les copropriétés placées sous administration provisoire par décision de justice.
Selon les estimations, le nombre de copropriétés potentiellement éligibles à ce nouveau régime est conséquent. En effet, à terme, ce sont entre 200 000 et 300 000 copropriétés qui pourraient être concernées par la nomination d’un syndic d’intérêt collectif.
Ainsi, les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte agréées remplissent les conditions pour exercer les fonctions de syndic d’intérêt collectif. De plus, un décret d’application doit venir préciser prochainement les conditions d’obtention de cet agrément. Notamment pour les syndics professionnels “classiques”.
Questions ouvertes et débats sur le syndic d’intérêt collectif
En effet, de nombreuses questions restent en suspens sur les modalités pratiques d’intervention de ce nouveau type d’acteur. D’ailleurs, elles ont été évoquées lors d’un colloque organisé à l’Assemblée Nationale par l’association QualiSR sur le sujet :
- Quelle sera la durée du mandat du syndic d’intérêt collectif ?
- Son contrat fera-t-il l’objet d’un modèle type établi par le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) ?
- Les syndicats d’intérêt collectif seront-ils officiellement “adoubés” par le CNTGI ou les préfets ?
- Quels seront les moyens alloués et les aides à la gestion accessibles pour leur permettre d’assurer leur mission sur des copropriétés en difficulté ?
Certification et formation des syndics
L’association QualiSR est une association loi de 1901. Créée en mars 2015, elle porte le projet d’une certification de syndics de redressement de copropriétés en fragilité ou en difficulté. Ainsi, Alain Papadopoulos, secrétaire général de l’association, propose de mettre en place une certification pour les syndics professionnels souhaitant obtenir cet agrément. Dès lors, on considérerait également les syndics certifiés QualiSR comme syndics d’intérêt collectif, afin d’élargir ‘le vivier’ de syndics professionnels et responsables. Une façon de garantir leur compétence spécifique sur les problématiques des copropriétés dégradées (surendettement, rénovation énergétique, lutte contre l’habitat indigne…).
Perspectives et réactions du secteur
Henry Buzy-Cazaux, président de l’Institut du Management des Services Immobiliers a également réagi. Il voit dans ce nouveau dispositif “l’espoir de réussir là où les syndics classiques ont souvent échoué : être aimé des Français !”
En effet, c’est là une occasion de redorer l’image des professionnels, avec ce rôle majeur de “redresseur” de copropriétés en péril. Ces nouveaux “héros” du logement collectif ont un vrai défi à relever. Toutefois, d’autres experts comme Loïc Cantin, président de la FNAIM, expriment des réserves. Ils critiquent cette notion.
“ Tout syndic digne de ce nom est par essence un syndic d’intérêt collectif ! Notre métier consiste justement à appliquer les lois et les règlements pour assurer la pérennité des copropriétés. Il est donc agaçant de voir ce rôle ainsi déconsidéré.” – Loïc Cantin.
Cela étant, il n’est pas contre la mise en place de formations spécifiques. Ainsi, ces formations enrichiraient les informations juridiques de la copropriété déjà disponibles. Elles permettraient à certains confrères expérimentés d’acquérir un niveau d’expertise complémentaire sur les copropriétés en difficulté. Comme un médecin généraliste peut décider de se spécialiser !
La saisie conservatoire : un outil efficace, mais à manier avec précaution
Autre innovation majeure de la loi “Habitat dégradé”, la saisie conservatoire des provisions de charges impayées introduite par le nouvel article 1244-4 du Code civil. Elle vise à renforcer les moyens d’action des syndics face aux copropriétaires mauvais payeurs. Cette mesure, qui fait partie des informations juridiques de la copropriété essentielles, permet de “geler” les comptes bancaires de ces derniers sans attendre une décision de justice. En cela, elle offre un effet de surprise appréciable pour enclencher un dialogue et trouver une solution amiable.

Mais, comme le détaille Charles Bohbot dans un récent article, plusieurs limites existent dans sa mise en œuvre :
- Le périmètre se restreint aux seules provisions votées en AG (article 14-1 de la loi de 1965) et aux dépenses de travaux (article 14-2). Ce qui exclut les arriérés de charges courantes, les cotisations au fonds travaux et les honoraires d’une procédure de recouvrement.
- L’obligation de délivrer un commandement de payer dans le mois suivant la saisie. Faute de quoi la mainlevée est automatique. Or les délais judiciaires actuels rendent l’exercice périlleux.
- La nécessité de convaincre le juge en cas de contestation de la réalité du péril dans le recouvrement. Ce qui est loin d’être évident au vu des garanties dont dispose le syndicat des copropriétaires.
“ Seule une analyse au cas par cas, tenant compte du profil et du comportement du débiteur, permettra de s’assurer de l’opportunité de la démarche. Des indices comme l’absence totale de dialogue, le non-respect de précédents échéanciers, l’existence d’autres hypothèques sur le lot peuvent constituer des éléments favorables. Mais, il ne faut pas en attendre de miracles !”, commente Charles Bohbot.
Les autres informations juridiques de la copropriété à suivre de près
Locations saisonnières : bientôt un encadrement renforcé ?
Adoptée par le Sénat le 21 mai 2024, la proposition de loi “visant à réguler et à contrôler les locations saisonnières” pourrait bientôt imposer de nouvelles contraintes aux propriétaires de meublés touristiques (type Airbnb) situés en copropriété. Outre l’obligation de respecter les mêmes critères de décence (dont la performance énergétique) que les locations classiques, le texte prévoit de soumettre tout changement d’usage à une autorisation préalable de l’assemblée générale.
Comme le précise l’article 1er : “Le règlement de copropriété peut soumettre la location d’un lot en meublé touristique à l’autorisation préalable de l’assemblée générale lorsque ce changement d’usage est de nature à générer des nuisances pour les autres occupants. L’autorisation peut être assortie d’une compensation financière au profit du syndicat des copropriétaires tenant compte de la perte de quiétude résidentielle”.
Cette mesure fait écho à la proposition récemment émise par la Mairie de Paris d’aller encore plus loin. Puisqu’il s’agit d’interdire purement et simplement la location de meublés touristiques dans les immeubles à usage d’habitation des arrondissements centraux (Ier, IIe, IIIe et IVe). Une façon selon l’adjoint au Logement Ian Brossat de “protéger un parc social de fait indispensable aux classes moyennes, aujourd’hui victime d’une gentrification par Airbnb interposé”.

Nous ne manquerons pas de suivre ces évolutions législatives et réglementaires lors de nos prochains points sur les informations juridiques en cours. En effet, une commission mixte paritaire devrait se réunir en juin pour tenter de trouver un accord entre députés et sénateurs. Charge ensuite au gouvernement de préciser les conditions d’application par décret, sous réserve que le calendrier politique le permette.
Signification de jugement : attention au délai de 6 mois !
Autre rappel important délivré par Maître Louna Grappe, avocate spécialisée en droit immobilier. Il faut impérativement signifier toute décision de justice dans les 6 mois suivant son prononcé pour conserver sa force exécutoire. Et, cela, conformément à l’article 478 du Code de procédure civile. Faute de quoi, le jugement est frappé de caducité et il faut alors reprendre la procédure à zéro.
“ C’est une règle trop souvent ignorée, y compris par certains syndics professionnels. Dans le cadre des contentieux de charges impayées ou de travaux non autorisés, il est fréquent de voir le dossier “endormi” de longs mois après une décision favorable. Parfois un changement de syndic fait perdre le fil. Le réveil est alors brutal pour le syndicat des copropriétaires qui voit ses efforts anéantis !”, commente Charles Bohbot.
Son conseil : mettre en place des procédures de suivi rigoureuses avec des alertes dans les logiciels de gestion et une centralisation des dossiers contentieux au niveau des services juridiques. Et, surtout ne jamais hésiter à relancer l’avocat ou l’huissier en charge de la signification pour s’assurer du bon déroulé des opérations dans les délais.
Informations juridiques et veille jurisprudentielle de la copropriété
Dépose illégale d’une installation privative : syndic et syndicat condamnés
Par un arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un syndic et un syndicat de copropriétaires, même autorisés par une décision d’assemblée générale, ne pouvaient procéder au démontage du conduit d’extraction des fumées d’un restaurant situé en rez-de-chaussée à l’occasion de travaux de ravalement.
En l’espèce, le syndicat avait refusé de procéder à la repose du conduit après les travaux, empêchant de fait la poursuite d’activité du commerce exploité par le copropriétaire et son locataire. Ces derniers ont alors engagé une procédure en référé pour trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile.

La Cour d’appel, confirmant l’ordonnance de première instance, a jugé que même en présence d’un vote d’assemblée générale, la dépose d’un équipement privatif servant à l’exploitation d’un lot constitue une atteinte aux droits du copropriétaire qui doit être autorisée par le juge à défaut d’accord de l’intéressé. Le syndicat a donc été condamné à remettre les lieux en état sous astreinte de 150 € par jour de retard et à verser des dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi par le restaurateur. Le syndic a également vu sa responsabilité retenue pour ne pas avoir correctement conseillé et alerté le syndicat des copropriétaires.
Cet arrêt (CA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 4 Avril 2024 – n° 23/14517) rappelle l’importance de respecter le droit de jouissance privatif des copropriétaires sur leur lot. Et, cela, même lorsque l’intérêt collectif est en jeu. Avant d’entreprendre tous travaux impactant les parties privatives, mieux vaut toujours privilégier la voie du dialogue et du consensus.
AG d’ASL : pas de mise en conformité des statuts sans respect du quorum
Parmi les informations juridiques de la copropriété en ce mois de mai, citons cette décision intéressante rendue le 25 avril 2024 par la troisième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 25-4-2024 n° 22-20.174 FS-B). À cet effet, l’assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) ne peut modifier ses statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 si le quorum requis par les statuts d’origine n’est pas atteint.
En l’espèce, une ASL avait tenté de modifier ses statuts datant de 1974 pour les adapter aux nouvelles règles issues de la réforme de 2004. Et, ainsi permettre notamment un vote des résolutions à la majorité simple. Mais, un membre de l’ASL a contesté la validité de la délibération, au motif que le quorum de 50% requis par les statuts d’origine pour leur modification n’était pas réuni.
Le tribunal lui a donné raison en rappelant qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance de 2004, codifié à l’article L. 211-5 du Code de l’environnement, “les associations syndicales libres peuvent adopter des statuts types approuvés par décret en Conseil d’État. Le choix de ces statuts types est décidé par l’assemblée générale de l’association syndicale libre, convoquée dans les conditions prévues par ses statuts”.
Dès lors, impossible de changer “en cours de route” les règles du jeu pour faciliter l’adoption de nouveaux statuts. Quand bien même ceux-ci seraient plus respectueux des dispositions légales en vigueur. Un principe de “parallélisme des formes” doit s’appliquer aux ASL comme aux copropriétés. Cet exemple montre l’importance de bien rédiger les statuts d’origine en anticipant d’éventuelles difficultés pour les faire évoluer, notamment sur les conditions de quorum et de majorité.
Chute dramatique en copropriété : quelle responsabilité pour le syndicat ?
Dans un arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Paris a reconnu la responsabilité d’une copropriété dans un grave accident survenu le 9 août 2014 (CA Paris, 22 juin 2023, n° 21/08742). Ce jour-là, Mme Y., qui rendait visite pour la première fois à un ami, M. X., a fait une chute de trois mètres après avoir été déséquilibrée par le chien de ce dernier. Elle s’était assise ou appuyée sur un muret délimitant une terrasse. Les circonstances exactes de la chute n’ont pas pu être établies avec certitude.
Les conséquences pour Mme Y. ont été dramatiques puisqu’elle est restée paraplégique. Le montant total de son préjudice a été évalué à 1,8 million d’euros. Mais, l’assureur du propriétaire du chien, la compagnie Pacifica, a refusé de prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation. Et, il a mis en cause la responsabilité de la copropriété, propriétaire du muret litigieux, assurée auprès d’Allianz.
Partage de responsabilités entre propriétaire du chien et copropriété
Cette dernière a également décliné sa garantie, estimant que la victime avait commis une faute d’imprudence en s’asseyant sur le muret. Le tribunal judiciaire de Paris, initialement saisi par Mme Y., avait pourtant jugé dans un premier temps le propriétaire du chien “entièrement responsable” sur le fondement de l’article 1243 du Code civil. En effet, cet article prévoit que “le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Mais, la cour d’appel, saisie par Pacifica, a finalement retenu un partage de responsabilités entre le propriétaire du chien et la copropriété. Tout en confirmant le rôle causal de l’animal dans la survenance de l’accident. Par ailleurs, les juges du second degré ont relevé que le muret, qui faisait partie des parties communes, constituait un “ouvrage de protection des personnes contre les risques de chute fortuite dans le vide”.
Obligation de mise en conformité des garde-corps pour les copropriétés
À ce titre, en application des articles 1240 et 1242 du Code civil, le syndicat des copropriétaires avait l’obligation de respecter les normes de sécurité en vigueur. En l’occurrence, celles fixées par la norme AFNOR NF P 01-012 relative aux garde-corps. Selon ce texte, lorsque les garde-corps sont “minces”, c’est-à-dire d’une largeur inférieure à 20 cm, ils doivent mesurer “au moins 1 mètre”. Or le muret ne dépassait pas 50 cm de hauteur.
La cour d’appel a donc jugé que la copropriété avait manqué à ses obligations en ne mettant pas en conformité cet équipement pourtant essentiel à la sécurité des occupants. En conséquence, la copropriété a été condamnée in solidum avec le propriétaire du chien à réparer le préjudice de Mme Y. Leurs assureurs respectifs, Allianz et Pacifica, devront donc prendre en charge chacun 50% de l’indemnisation de la victime, évaluée provisionnellement à 150 000 euros dans l’attente d’une expertise médicale définitive.
La responsabilité de plein droit des copropriétés en matière de sécurité des parties communes
Cette décision sévère est une illustration supplémentaire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur les syndicats de copropriétaires en matière de dommages causés par un défaut d’entretien des parties communes.
Comme le souligne l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.
Il appartient donc aux copropriétés de faire réaliser régulièrement des diagnostics techniques pour vérifier la conformité des équipements collectifs aux normes de sécurité en vigueur. Rappelons que depuis la loi ALUR de 2014, c’est même une obligation légale pour les immeubles de plus de 10 ans de faire établir un diagnostic technique global (DTG) tous les 10 ans. Ce DTG doit justement permettre d’identifier les non-conformités pour y remédier. Il en va de la sécurité des occupants, mais également de la responsabilité des copropriétaires. Un accident est vite arrivé.
Podcast Copro : votre rendez-vous pour décrypter les informations juridiques de la copropriété
Les informations juridiques de la copropriété évoluent en permanence, au gré des réformes législatives, des nouveaux règlements et de la jurisprudence qui ne cesse de préciser les contours du droit de la copropriété. Dans un contexte rendu encore plus complexe par l’instabilité politique actuelle, il est crucial pour tous les acteurs concernés (syndics, copropriétaires, conseils syndicaux…) de se tenir informés en temps réel des dernières nouveautés qui impactent la gestion et la valorisation de leur patrimoine immobilier.
C’est précisément la mission que s’est donnée “Podcast Copro”. Vous proposer régulièrement une synthèse claire et complète de l’actualité juridique des copropriétés, agrémentée de conseils pratiques. Avec notre émission, ne ratez plus aucune information essentielle ! Nous détaillons pour vous les derniers changements réglementaires et leurs conséquences sur votre copropriété.
En (re)découvrant nos précédents épisodes, vous pourrez aussi vous constituer une base de connaissances solide sur tous les aspects de la gestion d’une copropriété : travaux, charges, assemblées générales, règlement de copropriété, etc. Autant de sujets complexes, mais stratégiques qui nécessitent d’avoir des informations juridiques de la copropriété à jour et fiables.