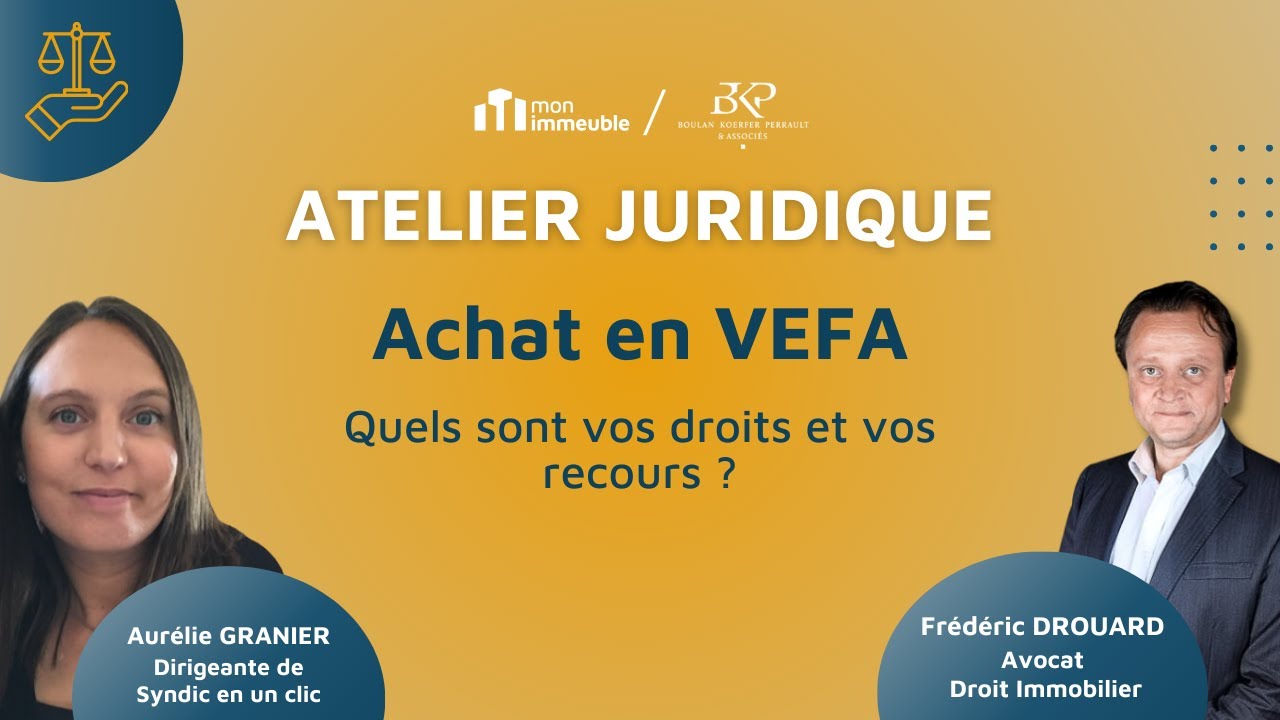Bienvenue dans “Podcast Copro”, votre rendez-vous mensuel pour explorer les méandres de la copropriété. Isabelle Dahan et Charles Bohbot, avocat associé du Cabinet BJA décortiquent pour vous les actualités juridiques de la copropriété. Ne manquez cette émission de 20 minutes, conçue pour vous accompagner dans la gestion de votre copropriété. Restez à l’écoute, “Podcast Copro” commence maintenant !
Sommaire :
- La sécurité des balcons en copropriété : une priorité avant les Jeux Olympiques
- Comprendre la nature juridique des balcons en copropriété
- Urgence en copropriété : la nécessité d’un diagnostic structurel ?
- Matera : la transformation en syndic professionnel local
- Inch acquiert Bellman : une nouvelle ère pour la Proptech
- Quitus et responsabilité du syndic : nouvelles précisions juridiques
- Accès aux parties communes : clarifications et conséquences pour les copropriétés
- Règles de notification des charges en copropriété : qui doit payer ?
- Accès et modification de la toiture terrasse en copropriété
- Obligation d’une nouvelle répartition des charges en cas d’annulation de l’ancienne grille
- Podcast Copro : votre bulletin mensuel sur la copropriété
La sécurité des balcons en copropriété : une priorité avant les Jeux Olympiques
À l’approche des Jeux olympiques, cet événement mondial génère de l’excitation, mais également des préoccupations, notamment en matière de sécurité. Concernant les dernières actualités juridiques de la copropriété, commençons par un sujet important. Récemment, la FNAIM du Grand Paris a mis en lumière un aspect essentiel. Il s’agit de la sécurité des balcons et des garde-corps. Alors que les JO 2024 approchent, l’attrait pour les meilleurs points de vue augmente. Cependant, cela soulève des inquiétudes. Les balcons, qu’ils soient parties communes ou privatives, pourraient être surchargés, présentant ainsi des risques d’effondrement.
> Consulter notre article sur : “Balcons parisiens pendant les JO 2024 : alertes et conseils de sécurité”
Cette mise en garde de la FNAIM est à prendre au sérieux. Historiquement, des accidents liés à des balcons en mauvais état se sont déjà produits. L’objectif est clair : éviter qu’un événement festif ne se transforme en tragédie. À cet effet, les syndics de copropriété jouent un rôle essentiel dans cette prévention. Puisqu’ils sont appelés à vérifier l’état des balcons et à informer les résidents des dangers potentiels. Cependant, leur accès limité aux espaces privés complique cette tâche. Dans ce contexte, la vigilance est de mise. Tandis que nous nous apprêtons à célébrer l’excellence sportive, la sécurité de chacun doit rester une priorité.
Comprendre la nature juridique des balcons en copropriété
Concernant la nature des balcons, parties communes ou privatives, cette distinction mérite une clarification. C’est pourquoi, Rahmouna Abdelhadi et Charles Bohbot ont mené un travail de fond qui apporte un nouvel éclairage sur cette problématique complexe. Jusqu’à présent, peu de ressources abordaient clairement la classification des balcons en droit de la copropriété. Or, une ambiguïté subsiste notamment due aux définitions parfois contradictoires fournies par le Code de la copropriété.
> Consulter l’article : “Le balcon en copropriété : partie privative ou partie commune ?”
Selon ce dernier, en l’absence de précisions dans le règlement de copropriété, un balcon peut être considéré sous deux angles différents. D’une part, la substructure, ou l’ossature du balcon, qui est souvent reliée à la structure principale du bâtiment. Elle est généralement classée comme partie commune. D’autre part, les éléments tels que les garde-corps ou les balustres. Ils constituent la partie superficielle du balcon et sont fréquemment considérés comme parties privatives.
Cette distinction n’est pas anodine, surtout lors des mises à jour des règlements de copropriété. À ce propos, les recommandations du Gréco encouragent une clarification des statuts des parties communes à jouissance privative. Les implications de cette distinction sont loin d’être théoriques, notamment en matière de rénovation ou de travaux. Les projets d’isolation thermique par l’extérieur, par exemple, touchent directement à la structure des balcons. Dans le contexte des actualités juridiques de la copropriété, ces interventions mettent en évidence des enjeux financiers significatifs. Elles rappellent l’importance de maîtriser et de définir avec précision la nature juridique des balcons au sein de la copropriété.
Urgence en copropriété : la nécessité d’un diagnostic structurel ?
Les récents effondrements d’immeubles à Marseille, Lille et maintenant Toulouse mettent en lumière une urgence nationale au cœur des actualités juridiques de la copropriété. Ces sinistres, survenant en plein cœur des villes, interpellent et inquiètent. En effet, la responsabilité des mairies s’affirme ici. Puisqu’elles doivent initier des mesures de mise en sécurité dès les premiers signalements. Cette situation met en lumière l’importance d’une compétence spécifique en matière de sécurité des bâtiments. Notons qu’un des moyens d’adresser ce problème réside dans les plans pluriannuels de travaux (PPT). Puisqu’ils permettent une meilleure anticipation des risques.
Ainsi, le débat sur le diagnostic structurel gagne en intensité. Professionnels et pouvoirs publics s’interrogent : faut-il rendre ce diagnostic systématique et obligatoire ? Les avis divergent. Certains soulignent le coût et la complexité de telles analyses. D’autres, cependant, réitèrent l’importance de ces évaluations pour prévenir les désastres.
À cet égard, le projet de loi sur l’habitat dégradé propose une avancée. L’article 126-6-1 envisage l’obligation de réaliser ce diagnostic dans certaines zones. De plus, il offre une perspective d’exonération pour les copropriétés proactive avec un plan de travaux intégrant les risques structurels. Nous sommes donc à un tournant. La législation s’adapte, les responsabilités s’affinent et le rôle des maires devient central dans la détection des zones à risque. Ainsi, l’anticipation par des diagnostics structuraux pourrait devenir un pilier de la sécurité urbaine.
Matera : la transformation en syndic professionnel local
La startup Matera, autrefois connue sous le nom d’Illicopro, prend un nouveau tournant. Rappelons qu’elle avait vivement critiqué les pratiques des syndics traditionnels à travers des campagnes publicitaires incisives. Or, désormais, l’entreprise se lance dans une offre de syndic professionnel local. Ce changement de cap suscite à la fois surprise et interrogation dans le secteur de la copropriété.
En effet, la distinction entre le rôle traditionnel de syndic et celui de Matera en tant que “syndic professionnel local” reste floue pour certains. Les procédures judiciaires antérieures et actuelles, relèvent des actualités juridiques de la copropriété. Ainsi, elles introduisent une dimension supplémentaire de complexité dans l’analyse de cette évolution.
“ Je représente l’Association nationale des gestionnaires de copropriétés dans une affaire cruciale. Nous menons cette procédure aux côtés de la FNAIM Grand Paris, du SNPI et de FONCIA. Un arrêt d’appel imminent abordera des questions essentielles telles que le dénigrement, les pratiques commerciales trompeuses et la violation de la loi Hoguet pour un exercice illégal sans carte professionnelle.” – Charles Bohbot.
Auparavant, Matera proposait une offre alternative au syndic traditionnel. Cette offre permettait aux copropriétaires de devenir eux-mêmes syndic. Cependant, la situation a évolué. Matera suggère maintenant d’exercer comme syndic professionnel. Ce qui ne représente pas simplement un changement de service, mais une transformation de leur modèle d’affaires.
Ainsi, la transition de Matera vers un statut de syndic professionnel, confirmée par leur inscription à la CCI, n’éclaircit pas complètement le paysage. Dans leur nouvelle offre, les copropriétaires qui choisissent d’être syndics bénévoles ou coopératifs reçoivent l’assistance de Matera. Cependant, Matera agit ici comme un prestataire de services, et non comme un syndic en tant que tel. Comment les copropriétaires distingueront-ils leur rôle et celui de Matera ? Cette ambiguïté pourrait-elle être considérée comme trompeuse ? La saga Matera est-elle loin d’être terminée !
Inch acquiert Bellman : une nouvelle ère pour la Proptech
Après une période marquée par des défis financiers et un redressement judiciaire, Bellman, a été rachetée par Inch et son fondateur, Thibaut Favre. Cette reprise représente une lueur d’espoir pour les 40 agences clientes et les 50 000 copropriétaires/bailleurs liés à Bellman.
Rappelons que Bellman, créée en 2019, a initialement démarré comme un syndic de copropriété. Pour ensuite pivoter vers un modèle d’affaires axé sur l’édition de logiciels. Cependant, les réalités économiques ont conduit Bellman à accumuler près de 5 millions d’euros de dettes. Ce qui a mené l’entreprise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en novembre 2023.
C’est finalement Inch qui a réussi à acquérir Bellman pour un montant de 100 000 euros. Fondée en 2014, Inch a fait ses preuves dans le développement d’une plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier. Avec un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros en 2023, l’entreprise se positionne comme un acteur solide pour reprendre les rênes de Bellman. Dans ce contexte de transition, les clients de Bellman peuvent entrevoir un avenir plus stable et prometteur.
Quitus et responsabilité du syndic : nouvelles précisions juridiques
Ce mois-ci, les actualités juridiques de la copropriété nous offrent plusieurs leçons précieuses. Ainsi, une décision de la Cour de cassation n° n°22-24.558 du 29 février 2024 apporte un nouvel éclairage sur la question du quitus accordé au syndic. Il est traditionnellement admis que lorsqu’un syndicat des copropriétaires vote le quitus, il approuve la gestion du syndic pour l’année écoulée. Mais, le cœur du sujet réside dans les conséquences de ce vote. En effet, le quitus exonère-t-il le syndic de toute responsabilité future ?

Cette récente jurisprudence précise que le quitus ne prive pas le copropriétaire de son droit d’action en responsabilité délictuelle. Autrement dit, même après l’octroi du quitus, un copropriétaire lésé peut toujours intenter une action si le préjudice subi découle d’une faute non contractuelle du syndic.
Cette clarification a des implications importantes. Car, certains pourraient penser que s’opposer systématiquement au quitus est une stratégie sage. Puisqu’elle maintient une forme de pression sur le syndic. Toutefois, cette approche peut être perçue comme contreproductive. En effet, elle pourrait indiquer un manque de confiance généralisé dans la gestion du syndic.
En cela, l’arrêt soulève une préoccupation. Puisque cette interprétation pourrait décourager les syndics de demander le quitus. Ce qui réduirait ainsi la transparence et la communication entre les parties. C’est pourquoi, il est essentiel de trouver un équilibre entre la nécessité de tenir le syndic responsable et la promotion d’une relation de confiance et de transparence. La critique systématique peut miner la collaboration nécessaire à la bonne gestion d’une copropriété.
Accès aux parties communes : clarifications et conséquences pour les copropriétés
La jurisprudence du 8 février 2024 n° 22-24.119 nous interpelle sur la définition et l’accès aux parties communes dans une copropriété. En effet, cette décision précise qu’en l’absence de parties communes spéciales désignées, tous les copropriétaires ont le droit d’accéder à l’ensemble des espaces de l’immeuble. Cette affirmation semble contre-intuitive. Surtout lorsque l’accès ne se justifie pas par l’utilisation réelle ou la configuration du lot du copropriétaire.
À cet effet, rappelons que les parties communes générales sont celles utilisées par l’ensemble des copropriétaires, telles que le sol ou les façades. Les parties communes spéciales, quant à elles, sont destinées à l’usage exclusif de certains copropriétaires, comme peut l’être un bâtiment annexe. Or, la récente décision de la Cour de cassation vient bousculer cette logique. Puisque même sans nécessité évidente, un copropriétaire peut exiger l’accès à toutes les zones. Y compris celles qu’il n’utilise pas et pour lesquelles il ne paie pas de charges spécifiques.
Comme on pouvait s’en douter, cette jurisprudence a provoqué diverses réactions. La question se pose. Faut-il accorder des badges ou des clés pour des espaces tels que les parkings aériens ou les locaux techniques à tous les copropriétaires, même à ceux n’en ayant pas l’utilité ?
Cette situation insolite amène à réfléchir sur la nécessité de réviser la loi de 1965, notamment son article 6-2. Il semble pertinent de proposer que les charges communes spéciales entraînent systématiquement la création de parties communes spéciales. Ainsi, cela éviterait que des copropriétaires non-contributeurs bénéficient indûment d’accès non nécessaires. Dans le contexte des actualités juridiques de la copropriété, un changement législatif pourrait se révéler avantageux pour uniformiser les pratiques et satisfaire de manière juste les besoins de l’ensemble des résidents.
Règles de notification des charges en copropriété : qui doit payer ?
Le transfert des charges de copropriété suite à une vente soulève souvent des questions pratiques et légales. Un arrêt n° 22-24.829 du 8 février 2024 nous éclaire sur ce sujet. Peut-on exiger du nouveau propriétaire le paiement des charges avant même que le syndic ait reçu la notification officielle de la vente ?
Dans le cas étudié, le syndic avait connaissance du changement de propriétaire grâce à des informations fournies par le notaire et le règlement anticipé des charges par le nouvel acquéreur.
Cependant, malgré cette connaissance anticipée, la Cour de cassation a maintenu une ligne stricte. En effet, la notification formelle est impérative. Sans cette notification officielle, le syndicat des copropriétaires doit continuer à adresser les demandes de paiement des charges au vendeur. C’est-à-dire à l’ancien propriétaire.
Cette décision souligne l’importance du formalisme dans la transmission des charges. Tant que la notification formelle, généralement effectuée par le notaire, n’a pas été reçue par le syndic, le nouvel acquéreur n’est pas considéré comme responsable des charges de copropriété. Ce principe vise à protéger tant les intérêts du syndicat des copropriétaires que ceux des nouveaux propriétaires.
Concrètement, cette jurisprudence appelle à une vigilance accrue de la part des syndics et des nouveaux acquéreurs. Pour les syndics, il est crucial de respecter le cadre légal et d’attendre la notification formelle avant de réajuster les comptes de charges. Quant aux nouveaux propriétaires, ils doivent s’assurer que la notification de la vente est bien envoyée au syndic pour éviter tout malentendu ou paiement incorrect. Cette clarification, dans le contexte des actualités juridiques de la copropriété, souligne l’importance du respect des procédures légales lors de la gestion des transitions de propriété en copropriété.
Accès et modification de la toiture terrasse en copropriété
Dans les immeubles en copropriété, l’accès à des espaces exclusifs comme la toiture terrasse est un sujet de convoitise. Un copropriétaire a cru pouvoir transformer cet espace en un magnifique rooftop. Pour cela, il s’appuie sur une clause du règlement de copropriété qui semblait lui accorder ce droit. En effet, cette clause stipulait que les propriétaires des derniers étages pouvaient modifier l’accès à la toiture. En outre, une décision de l’Assemblée Générale semblait valider cette possibilité.
Cependant, la Cour d’Appel de Paris a récemment rendu un verdict clarifiant cette situation. Dans son arrêt n° 20/06279 du 24 janvier 2024, elle a déterminé que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se dessaisir de ses droits sur les parties communes sans une décision adéquate de l’assemblée générale. Cela signifie que toute clause permettant automatiquement l’accès ou la modification de la toiture terrasse est considérée comme nulle. Autrement dit, elle est “réputée non écrite”.
Les parties communes restent sous la garde collective des copropriétaires
Ce jugement souligne un principe fondamental en copropriété : les parties communes restent sous la garde collective des copropriétaires. Pour qu’un individu puisse jouir d’une partie commune à titre privé, comme une toiture terrasse, il faut une modification du règlement de copropriété. Or, cette modification doit être approuvée en assemblée générale. Et, potentiellement, sous les conditions de la majorité de l’article 26, pouvant nécessiter une contrepartie financière.

Ce cas met en évidence la nécessité pour les copropriétaires de bien comprendre les règles régissant les modifications des parties communes. De plus, il rappelle l’importance de la procédure et du respect des décisions collectives en assemblée générale. Toute modification du règlement de copropriété doit être conforme aux lois en vigueur. En cela, l’établissement de parties communes à jouissance privative nécessite l’approbation unanime de la communauté des copropriétaires. Ce processus garantit, en fin de compte, l’équité et la conformité légale des modifications introduites.
Obligation d’une nouvelle répartition des charges en cas d’annulation de l’ancienne grille
Lorsqu’un juge constate que la grille de répartition des charges est invalide, il est tenu de proposer une nouvelle répartition. Cela découle d’un arrêt n° 22-21.579 daté du 25 janvier 2024, qui souligne un principe fondamental : le parallélisme des formes. En d’autres termes, si une règle est annulée, il faut en construire une nouvelle pour maintenir l’équilibre et la clarté dans la gestion de la copropriété.
Ce principe empêche de laisser un vide juridique après l’annulation d’une grille de charges considérée comme non écrite. L’idée est simple : on ne peut pas simplement supprimer une clause sans offrir de solution de remplacement. Cette approche vise à préserver la justice et l’équité au sein de la copropriété.
En tirant parti de cet arrêt, il est pertinent de se rappeler d’une jurisprudence antérieure, datant du 10 septembre 2020. En effet, Cet arrêt stipule que l’Assemblée Générale a le pouvoir de déclarer non écrite une ancienne répartition des charges, mais également de la remplacer par une nouvelle grille. Cela offre une voie pour éviter des litiges prolongés et onéreux.
Dans ce contexte, il est conseillé aux syndics de se munir d’un rapport détaillé élaboré par un géomètre expert. Ce document doit expliquer les raisons pour lesquelles l’ancienne répartition des charges est devenue obsolète ou injuste, et suggérer une nouvelle structure pour la répartition des charges. Ainsi, lors de l’Assemblée Générale, cette nouvelle grille peut être présentée et votée sans délai, évitant alors des procédures judiciaires longues et coûteuses.
Podcast Copro : votre bulletin mensuel sur la copropriété
Demeurez à l’avant-garde des actualités juridiques en copropriété grâce à notre podcast mensuel. “Podcast Copro” vous apporte une synthèse complète des dernières nouvelles, accompagné de conseils pratiques. Ne ratez pas notre prochaine diffusion pour approfondir votre compréhension du domaine.
Inscrivez-vous pour explorer nos épisodes antérieurs, riches en conseils et données essentielles pour une gestion optimale de votre copropriété. En suivant “Podcast Copro”, vous restez continuellement informé des dernières tendances et modifications légales affectant les copropriétés.