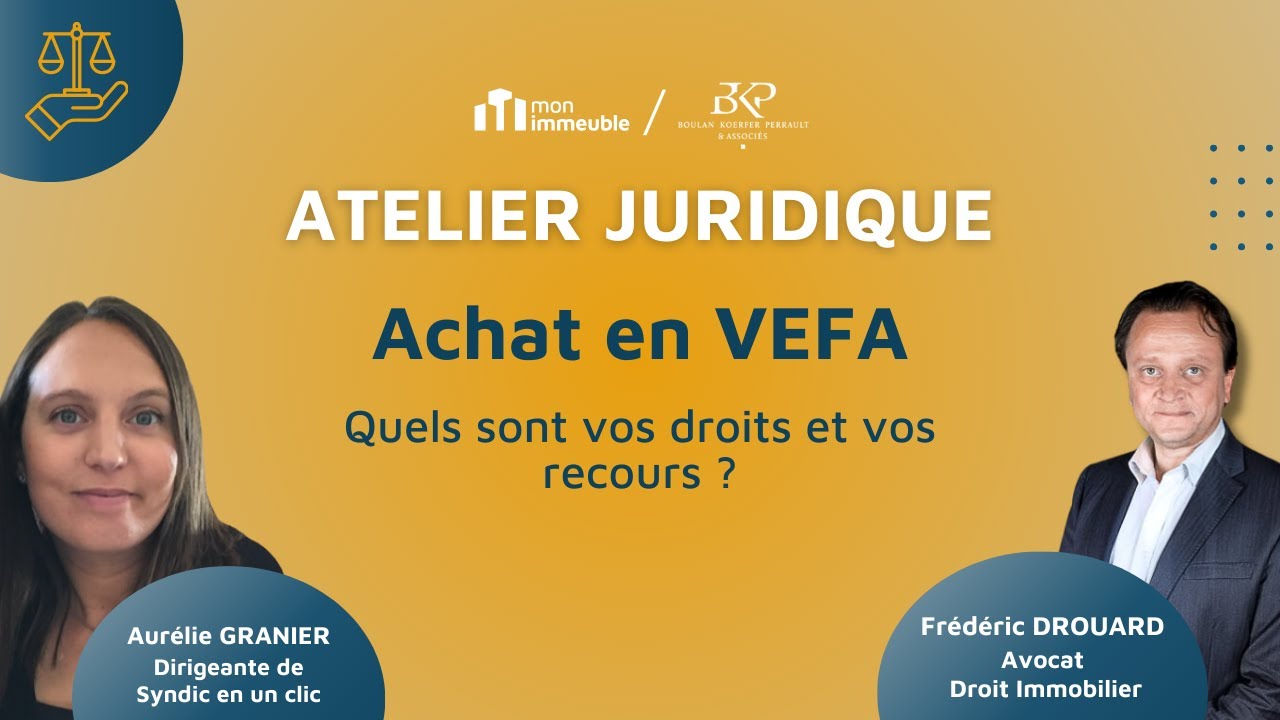Dans sa décision du 3 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question cruciale concernant le droit de préemption en zone d’aménagement différé (ZAD). En effet, l’arrêt n° 23-23.206 clarifie les règles d’évaluation des biens immobiliers en copropriété lorsqu’ils font l’objet d’une préemption par une collectivité. La haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, établissant que l’état dégradé des parties communes doit être pris en compte dans l’évaluation du prix, même si cette dégradation résulte de l’arrêt des travaux consécutif à la création de la ZAD. Cette décision a des implications majeures pour les propriétaires et les collectivités concernés par le droit de préemption.
Sommaire :
- Les faits et la procédure du litige
- Les principes juridiques applicables à l’évaluation d’un bien préempté
- L’impact de l’état des parties communes sur le prix de préemption
- Les conséquences de cette décision pour les propriétaires et les collectivités
Les faits et la procédure du litige
Contexte de l’affaire
L’affaire opposait l’établissement public foncier (EPF) à M. F., propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété. Le bien se trouvait dans une zone d’aménagement différé (ZAD), un outil d’urbanisme que les collectivités utilisent pour constituer des réserves foncières. M. F. avait notifié une déclaration d’intention d’aliéner à la commune de Menton, manifestant ainsi son souhait de vendre son bien. L’EPF, délégataire du droit de préemption, a alors exercé ce droit. Face à l’absence d’accord sur le prix, l’établissement public a saisi le juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes pour fixer le prix d’acquisition.

La ZAD, ou zone d’aménagement différé est est un outil juridique prévu par l’article L. 212-1 du Code de l’urbanisme. Son objectif : permettre aux collectivités locales de prendre progressivement la maîtrise foncière de terrains destinés à accueillir une opération d’aménagement. Concrètement, cela leur donne un droit de préemption renforcé sur ces parcelles. C’est un levier stratégique pour planifier le développement urbain à moyen ou long terme.
Parcours judiciaire
Le désaccord entre les parties a conduit à un contentieux qui s’est poursuivi jusqu’à la Cour de cassation. En première instance, le juge de l’expropriation a fixé un prix qui ne tenait pas compte de l’état dégradé de l’immeuble et des parties communes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 5 octobre 2023, a confirmé cette position. En effet, elle a ainsi estimé que la dégradation ne résultait pas d’une carence du propriétaire. Par conséquent, elle était la conséquence directe de la création de la ZAD, qui avait conduit à l’arrêt de tous travaux de rénovation et d’entretien.
L’EPF a alors saisi la Cour de cassation, faisant valoir que le prix du bien préempté devait être fixé en fonction de sa consistance matérielle à la date du jugement de première instance, sans tenir compte des causes de sa dégradation.
Les principes juridiques applicables à l’évaluation d’un bien préempté
Cadre légal du droit de préemption
Le droit de préemption est un mécanisme juridique qui permet à une collectivité publique d’acquérir prioritairement un bien immobilier mis en vente par son propriétaire. En matière de zone d’aménagement différé, ce droit est régi par l’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme. En outre, le texte prévoit que, en l’absence d’accord amiable, les juges fixent le prix d’acquisition d’un bien préempté — sans aucune indemnité accessoire — selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.
Principes d’évaluation en matière d’expropriation
Dès lors, dans le cadre de l’expropriation, l’article L. 322-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Ce principe fondamental vise à garantir une juste indemnisation du propriétaire exproprié. À cet effet, il tient compte de l’état réel du bien au moment où il en est dépossédé.
Spécificités des biens en copropriété
Toutefois, l’évaluation d’un lot de copropriété présente des particularités. Le bien en question comprenait deux éléments : des parties privatives, dont le propriétaire avait la jouissance exclusive, et une quote-part des parties communes.
Dans ce contexte, une question centrale se posait : fallait-il intégrer l’état dégradé des parties communes dans l’évaluation du prix du bien préempté ? Cette dégradation résultait de l’arrêt des travaux d’entretien, survenu après la création de la ZAD.
L’impact de l’état des parties communes sur le prix de préemption
La position de la cour d’appel
Dans cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une position nette. Puisqu’elle a estimé que l’état dégradé de l’immeuble et des parties communes ne devait pas être considéré dans la fixation du prix.
Pourquoi ? Parce que cette dégradation n’était pas imputable au propriétaire du lot préempté. Selon la cour, cette dégradation ne relevait pas du hasard. Elle s’expliquait par un enchaînement bien identifié : d’abord la création de la ZAD, puis la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition progressive des lots par l’expropriant. Cette dynamique a conduit à l’arrêt des travaux d’entretien et de rénovation, provoquant inévitablement la dégradation du bâti.
La solution retenue par la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation n’a pas retenu cette analyse. Elle a annulé la décision de la cour d’appel et a affirmé un principe clair : on doit fixer le prix du bien préempté en fonction de sa consistance au jour du jugement de première instance.
Concrètement, cela signifie une chose : l’évaluation du prix d’un bien situé en copropriété doit tenir compte de l’état réel du logement. Cela inclut non seulement les parties privatives, mais aussi les parties communes.
Et ce, même si les parties communes sont dégradées. La raison de cette dégradation importe peu. Même si elle résulte de l’arrêt des travaux d’entretien et de rénovation provoqué par la création de la ZAD, elle n’efface pas la réalité matérielle du bien au moment de l’évaluation.
La haute juridiction affirme ainsi la primauté du principe de réalité matérielle. Ce qui compte, c’est l’état réel du bien au moment de l’évaluation, non les raisons ayant conduit à sa détérioration. La Cour l’énonce sans ambiguïté : la circonstance selon laquelle la dégradation découle de la création de la ZAD est « étrangère à la consistance du bien ».
Les conséquences de cette décision pour les propriétaires et les collectivités
Impact pour les propriétaires de lots en copropriété
Cette décision de la Cour de cassation a des conséquences importantes pour les copropriétaires dont les lots se situent dans un immeuble compris dans le périmètre d’une ZAD. Désormais, ils se retrouvent dans une position plus vulnérable. Et pour cause : même si la dégradation des parties communes échappe à leur responsabilité, cet état sera tout de même pris en compte dans l’évaluation du bien en cas de préemption.
En pratique, cette logique pourrait entraîner un véritable cercle vicieux. La création d’une ZAD peut provoquer un désengagement progressif dans l’entretien de l’immeuble. Résultat : les parties communes se détériorent, et la valeur des lots restants s’en trouve diminuée. Les derniers copropriétaires à vendre subissent un désavantage par rapport à ceux qui ont cédé leur bien en début de processus d’acquisition foncière.
Conséquences pour les collectivités et établissements publics fonciers
Pour les collectivités et les établissements publics fonciers qui détiennent le droit de préemption, cette décision peut représenter un gain financier à court terme. Elle leur donne la possibilité d’acquérir des biens à un prix réduit, en tenant compte de leur état dégradé. Peu importe si cette dégradation résulte, au moins en partie, de leur propre stratégie d’acquisition progressive. La jurisprudence ne fait pas de distinction sur l’origine de la détérioration.
Mais, cette jurisprudence pourrait aussi avoir des effets contre-productifs. Face à ce risque de dévalorisation, certains propriétaires pourraient être tentés d’anticiper la vente de leur bien dès l’annonce de la création d’une ZAD. D’autres pourraient contester plus systématiquement les décisions de préemption. Conséquence : la mise en œuvre des projets d’aménagement urbain pourrait s’en trouver ralentie, voire fragilisée, par une méfiance accrue des propriétaires concernés.
Équilibre entre intérêt général et protection du droit de propriété
Cette décision de la Cour de cassation soulève donc une question de fond. Comment concilier l’intérêt général, qui justifie le recours au droit de préemption, avec la protection du droit de propriété ?
Certes, le principe d’une évaluation basée sur l’état réel du bien au jour du jugement de première instance respecte les règles classiques de l’expropriation. Mais, son application, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre spécifique des ZAD, peut susciter un sentiment d’injustice chez certains propriétaires.
Dans les faits, les propriétaires peuvent se retrouver pénalisés. Et pourtant, ils subissent une dégradation qu’ils n’ont pas provoquée. Celle-ci découle indirectement d’une opération d’aménagement engagée dans l’intérêt collectif. Autrement dit, ils subissent les effets d’un projet qu’ils n’ont ni décidé ni causé.